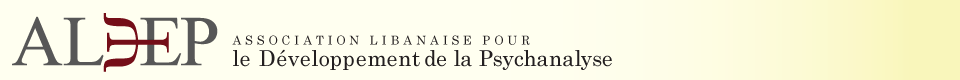L'autre : le dissemblable
(Conférence prononcée le 23 mars 2017 dans le cadre des conférences de l'Association Libanaise pour le Développement de la Psychanalyse).
Mon introduction est inspirée d’un poème qui a envahi médiatiquement, pendant l’hiver 2016, une grande population du monde arabe. Fortement touchée par les propos de ce jeune poète de la péninsule arabe dont j’ignore le nom, j’ai décidé alors de les partager avec vous. Je commence par quelques variantes sémantiques du concept de paix, retrouvées dans le texte du poète et qui montrent comment la langue arabe étale tout un réseau de significations qui découle du terme Salam (paix) :
سلام : salut ; salutation, paix ;
السلام عليكم : salut ! Que la paix soit avec vous (idée de Sécurité, de sûreté) ;
اسلم : retrouver quelqu’un sain et sauf ;
اسلم الرجل : professer la religion de l’islam, se faire musulman, se convertir à l’islam ;
اسلم الروح : rendre l’âme ;
اسلام : Islam (idée de résignation, de soumission à Dieu).
Cette prolifération étymologique repose sur une croyance collective en une première loi sacrée qui est l’essence même de la religion : la paix.
Nous habitons un pays de paix, berceau des trois religions monothéistes. Mais elle, la paix, ne nous habite plus et ne cesse de nous fuir.
Serait-ce une conséquence structurelle de notre différence, de par la race, l’ethnie ou la religion ? Le monde baigne actuellement dans la peur, le rejet, l’angoisse, dans une ambiance lourde et opaque. La religion de mes ancêtres, « l’islam paix », semble s’être rétractée. Sur la scène mondiale, s’affiche un islam étrange, inconnu, ayant perdu sa valeur de base, à savoir la paix. Nous avons affaire actuellement à un islam secret, clandestin, étrangement inquiétant (Freud, 1919) qui prend naissance un peu partout dans le monde.
Dans un Islam menaçant, Takfiri (accusation d’athéisme) qui ne nous concerne nullement, nous sommes face à la frayeur et à l’horreur. S’agit-il d’une époque où les valeurs supérieures se déprécient, où la « force violente de destruction atteint le maximum de sa force ? » (Biaggi, 1998)
Nietzsche l’appellerait nihilisme actif (le plus extrême) « (…) Parce qu’il n’y a point de vérité. (…) Le nihilisme représente un état pathologique, la conclusion qui n’aboutit à aucun sens ».
La question qui se pose alors serait de savoir pourquoi et comment est-on arrivé à cette impasse. Question certes vaste qui demande énormément de recherche, de dialogue, de renoncement et de sagesse. Pour ma part, je me permets de souligner et de soulever le problème.
Sommes-nous une société dite civilisée ? Peut-être prétendons-nous l’être. Au fond, serions-nous bien loin de ce statut ; nous serions une société sous-développée, arriérée, dans la postériorité. Freud affirme dans son article Nous et la mort (Freud, 1915), que tout autant que l’homme des temps originaires, notre inconscient est plein de désirs meurtriers et sanguinaires à l’égard de l’étranger, mais l’attitude, conventionnelle qu’on a adopté est en rapport à la civilisation. La civilisation est donc pour Freud l’unique issue de l’homme pour accepter l’autre. De nos jours et dans notre société, l’acceptation de la différence ne serait qu’une prothèse narcissique, une sorte de faux-self dont on se pare. La différence de la race, de l’ethnie, de la religion, même la différence sexuelle nous répugne, nous fait mal, « nous porte préjudice ».
L’avènement de la parole
Voyons ce qu’en disent les maîtres de la psychanalyse. « En parlant ça fait clair », dirait S. Freud. Bien sûr, puisque nous sommes des « parlêtres », avancerait J. Lacan. C’est-à-dire, celui qui pose la question de l’être du moment qu’il parle. L’impact de la parole sur l’individu est « magique ».
L’homme est donc un être de langage ; les mots tissent avec les images la réalité complexe et mouvante de ses rapports au monde, aux autres et à lui-même. L’hypothèse de Pierre Fédida est bien éclairante à ce sujet. D’après ce dernier, « si le langage est une loi rationnelle de lumière sans ombre, son étrangeté ne saurait alors être que celle de l’esprit conscient » (Fédida, 1994). Ainsi, les mots organisent l’espace d’un savoir qui ouvre tout aussitôt celui d’un « ne pas savoir », d’un « ne pas vouloir savoir », et aussi d’un « ne pas croire que l’on croit ». Le langage implique aussi que l’homme se sache mortel et n’empêche pas qu’il se refuse à y croire. « La mort n’est pas représentée dans l’inconscient », dit S. Freud. D’ailleurs, de tout temps, les hommes ont conjugué leurs efforts pour faire écran à cet incroyable savoir. En effet, si la mort peut être désignée, nommée, si elle a un nom dans toutes les langues, est-ce à dire pour autant que l’on puisse la penser, la concevoir ? Cela est moins sûr. D’ailleurs, le verbe concevoir a-t-il seulement un sens dans ce cas ? Puisque la mort est précisément l’inconcevable, l’impensable, l’inimaginable, l’irreprésentable : seuls des préfixes négatifs peuvent être accolés à ce qui la qualifie. La mort est la négativité, la non-entité, le non être, le néant absolu. L’on peut se demander, puisque la mort est précisément du domaine de l’irreprésentable, ce que voudrait maîtriser l’homme, dans les représentations de la mort que sont par exemple les squelettes et les cadavres ? Voudrait-il nier l’inéluctable de la mort ?
Je ferme cette parenthèse, à propos de notre relation à la mort, par la formule remarquable de Freud dans Totem et Tabou : « l’homme s’inclinerait devant l’inéluctabilité de la mort du même geste par lequel il la nie » (Freud, 1912). Ailleurs, il nous rappelle que « nous descendons d’une lignée infiniment longue de meurtriers qui avaient dans le sang le désir de tuer, comme peut-être nous-mêmes encore ». Est-ce pour dire que l’homme peut donner la mort à autrui, mais en même temps nie sa propre mort, à cause de cette puissance infantile bien ancrée dans son inconscient ?
Toutes les pathologies sont concernées par le rapport de l’homme à la mort. Cependant, dans le contexte qui nous intéresse ici, celui de la guerre, des attentats suicides, des attaques terroristes, il s’agit de la mort violente, brutale, subite, non pas dans son aboutissement naturel mais dans la suppression même de la vie.
Ce qui s’est passé en Irak, en Syrie et un peu partout dans le monde arabe serait un nouveau génocide. Le génocide est un crime – ce qu’on appelle un crime contre l’humanité ; un meurtre en quelque sorte absolu rendant possible l’inimaginable déshumain. Viol de femmes, portées à procréer des enfants d’un autre peuple au nom de la religion, massacres, tueries sauvages (peuple égorgé, brûlé vif), maisons et terres mises à feu et mises à sac, élimination du dialecte des hommes entre eux, de leurs rituels, de leur quotidien, déportation et exil, colonnes humaines interminables sur les routes…
L’horreur de l’extermination doit rester là sous les yeux pour terroriser, intimider… Tout ce qui ne m’est pas semblable, et qui ne se soumet pas à mes ordres, conditions, et croyance devrait disparaître.
Quel serait la nature de ce meurtre, en tous sens inqualifiable, qui ne tue pas comme on tue dans les guerres dites traditionnelles mais qui atteint un être dans sa racine et son appartenance religieuse ? Qu’est-ce que ce nihilisme qui touche à la violence destructrice, à la pulsion de mort dans son versant destructeur ? C’est l’identité universelle d’un homme qui est touché à mort par ce qu’il est à lui seul un peuple tout entier porteur de l’histoire de son origine.
L’extermination récente des Yazidiines est un exemple flagrant qui permet de comprendre l’ampleur de ce drame. Ce qui semble emporter ici le meurtrier dans sa folie génocidaire pourrait se lire sur les survivants : ils se retrouvent dans cet état d’errance, portant une douleur irreprésentable qui ressemble à ces angoisses autistiques où ne subsiste pas la moindre image, le moindre sentiment, la moindre parole. Pire encore : les descendants des survivants ne savent pas ce qui produit en eux une violence qui ignore son objet. Semblable violence pourrait être l’œuvre sinistre des meurtriers enjoignant aux descendants des survivants de détruire leurs propres enfants. C’est la violence psychique qui est ici à l’ordre du jour. La violence psychique a, dans ce cas, ceci de particulier qu’elle soumet ses victimes lointaines non seulement à l’impossible deuil mais à un véritable oubli de la mémoire de l’identité, oubli qui les fait agir aveuglément – comme dans un rêve – un incompréhensible meurtre dont le geste et sa victime seraient méconnaissables.
Et l’individu criminel, qui est-il ?
Je me permets d’esquisser ici quelques lignes, qui ne seront au fond qu’une ébauche pour comprendre d’avantage l’auteur, l’acteur du crime.
Par le crime, le meurtrier rejette certaines valeurs, trahit son groupe et s’isole peu à peu. Cette conduite asociale devient l’expression d’un conflit inconscient, la projection de ce conflit vers le dehors, la régulation particulière d’une économie pulsionnelle. Certes, le conflit est douloureux, souvent inefficace, marqué d’un « mal de l’autre ». Du même coup, la criminalité n’est plus envisagée comme simple exposé d’une absence « de l’autre », ou l’expression « visible » d’une autre scène ; elle devient la preuve d’un véritable réajustement, une régulation spécifique où l’on peut lire un itinéraire, où se crie l’angoisse d’un sujet, perdu entre une négation de soi vécue dès l’enfance et la « néantisation d’un autre ». L’attentat de Nice, en juillet 2016, est bien éclairant à ce propos. Le criminel s’est emparé d’un camion pour accomplir son acte fou, afin d’anéantir les autres, et lui-même. Selon l’hypothèse de Daniel Rosé, c’est la reconnaissance de la haine de soi au fondement de tout le mal, dans son couplage brutal avec le plaisir tout-puissant. Pour comprendre dans toute sa dramatique cette haine de soi, il faut donc, tenir ensemble deux choses contradictoires : l’investissement sans limite de l’anéantissement de l’autre qui, ainsi, devient « mien », et le rejet violent de ce que je suis alors. Dans D’autres discours psychanalytiques, se réclamant de J. Lacan, de C. Clément et de P. Legendre, le criminel devient d’une manière ou d’une autre un être « en abandon » sans fiction ni limites, désespéré de filiation et s’identifiant à une place « interdite ».
Revenons à l’autre, le dissemblable et à l’altérité
Selon l’ethnologie structurale, une civilisation privée d’altérité meurt. L’altérité doit donc exister dans la civilisation. Cette dimension de l’ailleurs et de l’altérité en général, peut fonder une éthique correspondant à l’état du monde d’aujourd’hui. Vivre à côté l’un de l’autre, « le voisinage », est la donnée majeure de la civilisation.
Certes, l’étranger n’est, comme l’ailleurs et « l’autre chose », qu’une figure de l’altérité qui, en tant que telle, n’aurait pas besoin d’être figurée, et qui est parfois défigurée par ces figurations. Si, dans la vie sociale, nous étions capables de respecter l’altérité contenue dans le seul fait de parler et d’user de langage, la question d’une éthique ne se poserait pas. La nécessité d’une éthique, dont la caractéristique psychique dans le social est toujours surmoïque, est de tempérer la pulsion de destruction à l’œuvre dans la civilisation. Or celle-ci prend aujourd’hui la forme de la ségrégation et de la discrimination, en raison du trait majeur de la civilisation contemporaine. Lévi-Strauss insiste sur la collaboration des hommes entre eux, afin de progresser. Et au cours de cette collaboration, ils voient graduellement s’identifier les apports dont la diversité était précisément ce qui rendait leur collaboration féconde et nécessaire.
Ainsi le voisin doit rester l’autre, « le dissemblable ». La place qu’on laisse à l’altérité va pacifier le voisinage.
Une civilisation est privée d’altérité soit quand l’altérité la fuit, soit quand elle fuit l’altérité, à toutes les échelles et à tous les degrés. C’est donc un enjeu de la civilisation contemporaine que de savoir reconnaître le voisinage là où il existe. Les frontières bougent, mais le voisinage persiste.
Parce que notre civilisation est celle de la mobilité généralisée, elle est aussi celle des migrations. De ce fait, les migrants sont les voisins par excellence et un enjeu d’une éthique du voisinage réside dans le fait de ne pas les tenir pour des voisins subalternes (voisiner avec la pauvreté) mais des voisins d’à côté, (démocratie de voisinage). L’attraction exercée par les pays vers lesquels on migre doit être perçue comme une chance de ne pas mourir d’étouffement dans la logique du même. Ceux qui prennent le risque de mourir pour aller ailleurs que là d’où ils viennent, chassés par la guerre ou la famine, donnent à la civilisation une chance de ne pas mourir. Cette chance ne peut s’actualiser que si elle ne se heurte pas à un refus et si l’on a bien conscience que les voisins doivent être des alliés, qu’il doit y avoir « coalition », pour reprendre le mot de Lévi-Strauss, échange et pas seulement solidarité ou compassion.
« L’autre est indispensable à mon existence », d’après Jean-Paul Sartre, aussi bien qu’à la connaissance que j’ai de moi. Dans ces conditions, la découverte de mon intimité me découvre en même temps que l’autre, comme une liberté posée en face de moi, qui me pense, et qui serait pour ou contre moi (Sartre, 1943).
En fait, ce contact avec l’autre prend corps réellement à l’adolescence chez chaque individu. F. Ladame insiste sur l’indispensabilité d’un sentiment d’identité, un sentiment d’existence propre, pour aller à la rencontre de l’autre, pour sortir du dilemme narcissico-objectal. La solution à ce dilemme qui finit par s’imposer consiste à opter à la fois pour soi et pour l’autre, il y a place tant pour soi que pour l’autre.
Chacun de nous est le dérivé des autres qui le précédent et qui l’entourent, et lui-même participe à la formation de tous ceux qu’il rencontre : le « je » dépend toujours « d’autrui », et le « nous », « des autres » : c’est la seule immortalité qui vaille.
Je termine ma réflexion sur l’autre et sur soi par ces jolies et profondes phrases de Tzvetan Todorov dans Vivre seuls ensemble, dans les jours qui précèdent la mort de Goethe, probablement habité par l’obscur pressentiment du moment où la terre absorbera son corps et où lui-même se confondra avec l’univers objectif ; Goethe ne pense qu’à une chose : que son esprit n’est que le résultat des mille et une absorptions, que son originalité consiste en une capacité de tout assimiler, que l’être est l’autre. C’est au moment même où il n’existera plus que dans et par l’esprit des autres, que Goethe reconnaît pleinement les autres en lui, seule immortalité qui vaille : les autres vivent en nous, nous vivons dans les autres. D’une transformation antérieure, nous ne sommes que la transformation, qui sera transformée à son tour.
Telle est l’apothéose de Goethe : au moment même où son corps périssable est destiné à se perdre dans la matière, son esprit reconnaît qu’il n’est que mémoire, et il se livre sans méfiance à la mémoire des autres, contemporains et futurs lecteurs.
Ce que j’ai avancé est une première réflexion. Une réflexion qui a pour objectif d’ouvrir la voie à d’autres questionnements et perspectives. Mais le plus poignant reste le témoignage, qui donne à la réflexion sa matière vivante. Volontaire ou médiateur, le témoin appelle, par sa parole à une mise en histoire.
Ce soir, nous avons un témoignage précieux. L’ALDeP à le plaisir d’accueillir le Dr Adel Akl, psychiatre, psychanalyste et l’un des pionniers de la psychanalyse au Liban, qui nous apportera son précieux témoignage autour d’un événement ayant eu lieu durant la guerre du Liban. Ce témoignage condense un acte violent saisi par une parole qui vient authentifier le vécu d’un survivant.
Références bibliographiques
Aïn J., Violences, racines ou destins des pulsions ? Érès, 1994.
Altoumian J., La survivance, Dunod, Paris, 2000.
Biaggi V., Le nihilisme, Flammarion, Paris, 1998, p. 120-130.
Bergeret J., La violence fondamentale, Dunod, Paris, 1984.
Devereux G., La renonciation à l’identité ; Défense contre l’anéantissement, Payot, 2009.
Erman M., Le lien d’amitié, Plon, 2016.
Fédida P., Compter les morts. Guerres, L'inactuel, Paris, Calmann lévy, 1994, pp. 49-59.
Freud S. (1912-1913), Totem et Tabou, trad. fr. M. Weber, Paris, Gallimard, 1993 ; OCF.P, XI, 1998 ; GW, IX.
Freud S. (1915), Nous et la mort, Conférence, trad. fr. M. Pollak-Cornillot, Revue Française de Psychanalyse, t. LXIV, n° 3, 2000 ; GW, X.
Freud S. (1919), L’inquiétante étrangeté, L’inquiétante étrangeté et autres essais, trad. fr. A. Bourguignon, Paris, Gallimard, 1985 ; GW, XII.
L’Heuillet H., Du voisinage ; Réflexions sur la coexistence humaine, Albin Michel, Essai, 2016.
Labadie J.-M., Les mots du crime, Presses universitaires de Montréal, 1995.
Levinas E., Le temps et l’autre, Puf, Paris, 1983.
Lacan J., Motifs du crime paranoïaque : le crime des sœurs Papin, De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité, suivi de Premiers écrits sur la paranoïa, Paris, Le Seuil, 1975.
Nietzsche F., Par-delà bien et mal, Gallimard, 1971.
Osseiran-Houbballah M., L’enfant-soldat ; victime transformée en bourreau, Odile Jacob, Paris, 2003.
Rosé D., Pourquoi le mal ? Violences, Érès, 1994, pp. 37-54.
Ricard M., Revel J.-F, Le moine et le philosophe ; un père et son fils débattent du sens de la vie, Nil, 1997.
Sartre J.-P., L’existentialisme est un humanisme, Gallimard, 1996.
Sartre J.-P., L’être et le néant, Gallimard, 1943.
Todorov T., Nous et les autres, Seuil, 1989.
Todorov T., Vivre seuls ensemble, Points, Seuil, 2009.
Vincent J.-P., Qu’est-ce que les conservatismes ? Belles lettres, Paris, 2016.