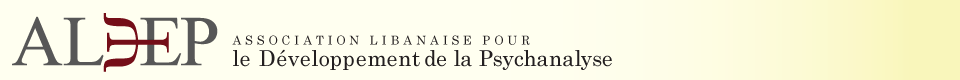Quand le trauma s'empare du corps
(Conférence prononcée le 21 février 2013 dans le cadre des conférences de l'Association Libanaise pour le Développement de la Psychanalyse).
L’intérêt pour le rapport psyché/soma dans la recherche et la pratique psychanalytiques n’est plus vraiment une option. Qu’on soit psychanalyste ou psychanalyste psychosomaticien, la confrontation à la réalité psychosomatique, à la vulnérabilité psychosomatique et à l’intimité organique du psychique et du somatique devient le lot de tout praticien.
En réponse aux collègues qui me demandaient au début de ma pratique psychanalytique si je m’intéressais à la psychosomatique, ma réponse était souvent : « Non. Pas vraiment… mais peut-être que cela viendra un jour ».
Réaction sincère mais également, réaction compatissante avec leur intérêt sur la question, ou bien intuition personnelle d’un intérêt dormant, en ce temps- là ; en tout cas, cela venait en écho à ma profonde conviction du lien organique qui relie incontestablement et quasi systématiquement le langage (ou le pré-langage) symptomatique du corps et le fonctionnement psychique. Un écho surtout à l’écoute du temps de la maladie ou de la défaillance somatique au cours d’un processus psychanalytique.
Un temps où, débordées par un trop-plein d’excitation, les pensées et les représentations, « dépassées par les événements », invitent le corps à l’action ; elles invitent le corps à l’acte, avec tout ce que la notion d’acte suppose en psychanalyse, l’acte comme envers de la parole, l’acte comme agir dans le soma (l’acting in qu’on oppose à l’acting out) mais aussi, l’acte somatique comme salut ou comme espace qui attend une reprise de l’élaboration psychique – même si parfois la maladie s’ancre dans le soma au point de menacer la vie. Et bien entendu, une régression aux tréfonds de la vie somatopsychique n’est pas toujours facile à éprouver ; par l’analysant, et encore plus par l’analyste qui en témoigne.
Que le conflit psychique (par un travail du Moi) ou la position de l’appareil psychique par rapport au conflit (qui peut être un échec de ce travail) ait des retombées plus ou moins virulentes sur le corps n’est plus vraiment à démontrer, comme l’attestent les symptômes hystériques de conversion, les troubles fonctionnels (constipation ou diarrhées chroniques, palpitations, spasmes intestinaux, migraine, nausées et vomissements, etc. – tout le bruitage d’un corps supposé silencieux) ou les maladies dites psychosomatiques dans lesquelles on observe une altération de l’organe touché (Eczéma, ulcère, rectocolites hémorragiques, psoriasis…). Et ce qui est actuellement sujet à débat, ce sont les maladies somatiques plus ou moins graves et leur relation au fonctionnement psychique.
Ou encore et en poussant la logique plus loin, toute maladie organique a-t-elle nécessairement son lien avec le psychique (effet ou cause ? – alors que dans la réalité le déterminisme est beaucoup plus complexe) ? J’userai ici du concept de récursivité d’Edgar Morin qui, dans la détermination des événements parle de « boucle génératrice dans laquelle les produits et les effets sont eux-mêmes producteurs et causateurs de ce qui les produit », l’effet devenant à son tour cause. Ou encore, qu’est ce qui fait qu’une maladie se déclenche à un moment précis de l’évolution d’une vie ?
Je pense ici à une autre catégorie de maladies somatiques plus ou moins graves et dont l’étiologie reste mystérieuse en grande partie. La littérature évoque ici certains cancers, certaines épilepsies et ce qu’on appelle les maladies auto-immunes : maladie de Basedow (hyperthyroïdie), thyroïdite chronique de Hashimoto (hypothyroïdie), lupus érythémateux disséminé (LED), myasthénie, diabète par insulinorésistance, purpura thrombocytopénique auto-immun, polyarthrite rhumatoïde, polymyosite et dermatomyosite, anémie de Biermer, certaines stérilités…, maladies dans lesquelles le système de défense supposé protéger l’organisme, se retourne contre lui et l’attaque par ses anti-corps ; ce sont des maladies caractérisées par une agression de l'organisme par son propre système immunitaire – plus de différence entre l’extérieur et l’intérieur. L’intérieur devient aussi étranger que l’extérieur.
Appliquée au psychisme, la métaphore bien connue des objets internes encore étrangers, non élaborés, et qui font des ravages, peut nous servir de comparaison : l’objet étranger qui attaque est au-dedans, dans notre propre système.
Aux deux précédentes questions, la médecine est encore incapable de répondre. Ce qu’elle sait, c’est qu’à un moment donné, la maladie se déclenche ; la médecine peut désormais agir sur la maladie à partir du moment où elle s’annonce. Avant, ce qui a pu la déclencher, reste énigmatique. C’est ce qu’en dit, dans une interview menée par C. Smadja et G. Szwec, le chef de service d’endocrinologie et de diabétologie à l’hôpital Saint-Joseph à Paris (M. Hautecouverture) quand il affirme qu’ « à partir du moment où l’on a identifié un taux significatif d’auto-anti-corps, tout est simple. C’est avant que rien n’est réglé […] à partir du moment où on a la caractérisation biochimique, la nature biochimique, la conformation spatiale de ces anti-corps, les choses deviennent plus simples. […] Tout le problème c’est avant. Lorsque le processus est enclenché, cela devient compréhensible » (M. Hautecouverture, 2003).
Les auteurs et les courants de pensée qui ont axé leurs recherches sur les tenants et les aboutissants des effets des mécanismes psychiques sur le corps se distinguent entre ceux qui depuis Freud et son commentaire sur l’épilepsie de Dostoïevski (pour Freud, l’épilepsie de l’écrivain serait un symptôme hystérique autopunitif, traduisant un intense sentiment de culpabilité relatif à son désir de mort envers son père) y ont vu un rapport avec l’hystérie, le conflit névrotique et la bisexualité psychique, et ceux qui ont décelé derrière les symptômes psychosomatiques, un fonctionnement psychique spécifique, quasi constant et se situant en-deçà du fantasme et du conflit psychique. C’est à ceux-là que nous devons les expressions bien connues dans la littérature, de fonctionnement psychique, de pensée opératoire, de non-mentalisation et du triptyque organisation/désorganisation/réorganisation (P. Marty) ; dans leur théorie « économique », ces auteurs expliquent le symptôme psychosomatique comme un blocage dans la capacité de représenter, de mentaliser et d’élaborer les demandes instinctuelles que le corps (les pulsions) impose au psychisme et qui font retour dans le corps.
Une troisième compréhension du phénomène est représentée par la pensée d’auteurs comme J. McDougall qui voient dans la vulnérabilité psychosomatique, non pas un défaut de mentalisation, mais une défense archaïque contre des angoisses psychotiques. S’inspirant de D. W. Winnicott, de la continuité somato-psychique et de la liaison entre soma et psyché assurée à l’enfant par la mère, McDougall pense que la scission psyché-soma se produit quand l’enfant est obligé de se défendre par un clivage (psyché/soma) pour éviter la menace d’une rupture dans sa continuité narcissique et contre le danger d’anéantissement.
Sur un autre plan, et si l’on admet avec les psychanalystes psychosomaticiens que les maladies psychosomatiques, voire somatiques, sont inversement proportionnelles à la capacité de mentalisation et d’élaboration d’un conflit ou d’un trauma, qu’en serait-il d’autres cas de figure, comme celui de Ferenczi (pour citer un cas illustre), de la maladie qui lui a coûté la vie et de ce qu’il en dit en 1932 dans son Journal clinique quelques mois avant sa mort : « Une certaine force de mon organisation psychologique semble subsister, de sorte qu’au lieu de tomber malade psychiquement, je ne peux détruire – ou être détruit – que dans les profondeurs organiques. » (S. Ferenczi, 1932) Il était bien conscient des forces destructrices qui avaient scellé sa relation avec Freud et l’impasse relationnelle et théorique dans laquelle les deux hommes se sont retrouvés.
Ferenczi est décédé quelques mois plus tard des suites d’une maladie aujourd’hui considérée comme auto-immune et qui est l’anémie de Biermer (Anémie due à une anomalie d'absorption de la vitamine B12 dans l'estomac).
Comment l’avidité élaborative de ses propres processus inconscients et son savoir poussé des mécanismes psychiques les plus archaïques, n’ont-ils pas pu aider Ferenczi à un rééquilibrage somato-psychique suffisant qui puisse le sauver d’une maladie fatale ?
Autant de questions que j’aborde avec vous ce soir en essayant d’en dégager quelques voies de réflexions.
Premiers tâtonnements de Freud sur le sujet
Je ne m’attarderai pas sur les premières recherches freudiennes concernant l’hystérie, recherches supposées connues, et qui ont le mérite de mettre en articulation les notions de traumatisme, d’énergie psychique qui prend la voie de l’innervation corporelle, de fonction symbolique du symptôme, symptôme comme commémoration d’un événement refoulé, et de valeur de compromis qui réunit en même temps l’expression du sexuel refoulé, et la censure refoulante du moi (censure de la première topique, qui évoluera et se complexifiera dans la pensée de Freud pour devenir le surmoi de la deuxième topique).
Jusque-là donc, l’omniprésence de la clinique de l’hystérie était telle qu’il n’y avait pas vraiment d’autres modèles structurés qui puissent rendre compte de symptômes somatiques liés au psychique et qui n’obéissaient pas nécessairement à cette dynamique de l’hystérie.
En témoigne son point de vue sur l’épilepsie de Dostoïevski qu’il discute déjà dans son échange épistolaire avec Stefan Zweig, sept ans avant la parution de son article de 1928, Dostoïevski et le parricide. Dans une lettre à Zweig en 1920, il dit qu’il est très improbable que Dostoïevski ait été épileptique et que « Tous les grands hommes dont on raconte qu’ils étaient épileptiques n’étaient rien d’autre que des hystériques ». Pour lui, l’épilepsie est une « affection organique du cerveau, extérieure à la constitution psychique, et généralement liée à une diminution et à une simplification des capacités psychiques ». Plus loin, il écrit : « L’hystérie tire son origine de la constitution psychique elle-même, elle est une expression de la même force originelle archaïque qui se développe dans l’activité de l’artiste génial. » Et puis de continuer en établissant un rapport entre « les souffrances ultérieures de l’adulte et une punition infligée par le père au jeune garçon dans de très graves circonstances » (S. Freud, S. Zweig, 1927-1939). Huit ans après Freud publie son essai sur l’épilepsie de Dostoïevski, essai bien plus convaincant dans son analyse de l’ « hystérie de l’auteur ».
À la même époque (époque de la correspondance avec Zweig), et en 1917, le point de vue de G. Groddeck est annoncé à Freud. Pour lui, l’expressivité, la force, voire l’omnipuissance du Ça sont telles qu’elles peuvent tout autant s’exprimer dans des maladies somatiques comme la pneumonie et le cancer, que dans la névrose obsessionnelle. Donc pour lui, pas de différenciation, comme chez Freud, dans le rapport psyché/soma, c’est-à-dire la manière par laquelle le fonctionnement psychique va déterminer la nature – psychique ou somatique – de la maladie. Comme si, pour lui, le psychique était un « organe du corps », comme un autre. Ce qui manque à cette conception, comme l’avance C. Smadja, « c’est l’épaisseur d’un processus qui rende intelligibles les transformations du psychique au somatique […] et les attributions de sens à des états du corps au cours d’opérations de symbolisation secondaire » (C. Smadja, 2008).
Donc, mis à part ses travaux sur l’hystérie et sa description, déjà ancienne (1896), des différentes psychonévroses de défense qu’il distinguait des névroses actuelles (neurasthénie, névrose d’angoisse et hypocondrie), ces dernières (l’hystérie mise à part), ayant plus d’implications somatiques que les premières, Freud semblait réservé et prudent quant il parlait de déterminations psychiques dans les maladies somatiques franches. Il soulignait cependant la présence d’un facteur psychique dans la genèse et l’entretien de la maladie somatique : « le traitement analytique des atteintes organiques franches n’est pas non plus sans avenir (Jelliffe, Groddeck, Félix Deutsch), puisqu’il n’est pas rare qu’un facteur psychique prenne part à la genèse et à la persistance de ces affections » (Psychanalyse et Théorie de la libido, Encyclopédie de M. Marcuse, 1923). En 1924 et dans Court abrégé de psychanalyse, il renouvelle en confirmant : « J’ajoute que, parmi les thérapeutes, des voix se sont élevées (Groddeck, Jelliffe) qui tiennent pour prometteur même le traitement psychanalytiques de graves souffrances organiques, étant donné que dans beaucoup de ces affections est également entré en jeu un facteur psychique sur lequel on peut acquérir de l’influence. »
Gardons à l’esprit que quand Freud avance ces allégations, son cancer de la mâchoire venait de se déclarer. Trois ans auparavant, en 1920, il avait perdu sa fille Sophie d’une pneumonie grippale ; et en 1923, son petit-fils préféré Heinerle, l’un des deux fils de Sophie, disparait tragiquement à son tour. Dans l’une de ses correspondances, il écrit : « Je supporte très mal cette perte, je crois n'avoir jamais éprouvé un tel chagrin peut-être le choc est-il plus durement ressenti du fait de ma propre maladie. Je travaille contraint et forcé dans le fond, tout m'est devenu indifférent. » (A Kata et Lajos Levy).
Dans une lettre à Ferenczi le 8 mai 1921 – donc après la mort de Sophie –, il écrit : « Le 13 mars de cette année, je suis entré brusquement dans la véritable vieillesse. Depuis, la pensée de la mort ne m'a pas quitté, et quelquefois j'ai l'impression que sept de mes organes internes se disputent l'honneur de mettre fin à ma vie. [...] Malgré tout je n'ai pas succombé à cette hypocondrie mais je la contemple avec détachement, un peu comme pour les spéculations d'Au-delà du principe de plaisir. »
Donc, perte du goût de vivre, indifférence, tel est l’état d’âme d’un Freud meurtri, mais déterminé quand même à continuer, avec détachement, dit-il, comme pour ses spéculations théoriques. C’est dire donc l’intérêt, à ce stade, de la solution continue par la théorie, sur fond de maladie – le cancer qui lui a coûté la vie – après seize interventions chirurgicales (d’autres références font état de 32) avec, dès la deuxième intervention, la mise en place d’une prothèse qui sépare la bouche de la cavité nasale, et qu’il appelait : le monstre.
Je ne rentrerai pas ici dans des spéculations stériles sur le déterminisme de son cancer mais ferai remarquer la façon par laquelle Freud opte pour la survie, mais avec, en revanche, une pensée curieusement parlante concernant son inquiétude de se faire attaquer de l’intérieur : « …quelquefois j'ai l'impression que sept de mes organes internes se disputent l'honneur de mettre fin à ma vie. »
Nous ne pouvons ici nous empêcher de penser justement à ce « système immunitaire » qui peut attaquer l’organe, au lieu d’attaquer le corps étranger pour protéger l’organisme.
Mais malgré tout, il réussit relativement dans ses procédés de survie – il survécut à son cancer une quinzaine d’années avant de succomber – là où Ferenczi, dans ses positions et ses débats aussi bien relationnels que théoriques avec Freud, succomba très tôt à une anémie de Biermer.
Qu’en est-il des tenants et aboutissants de la maladie de Ferenczi, maladie qui ne peut être isolée de son parcours, son compagnonnage avec Freud, sa relation ambivalente à son endroit, ainsi que sa position à l’égard de la clinique psychanalytique et sa chasse éperdue au trauma ?
Ferenczi et sa maladie
En 1933, Ferenczi succombe à une anémie de Biermer, non sans avoir lutté en essayant d’élaborer, dans sa théorie et dans sa relation à Freud, ce qui, des profondeurs organiques, fait retour.
Nous savons par ailleurs que pour Ferenczi, la « vérité » traumatique dans la répétition et la régression sans limite a priori, jouée dans la relation transféro-contre-transférentielle, se joue parfois au prix d’une régression psychotique de laquelle « on aurait tort de s’en alarmer outre mesure » (S. Ferenczi, 1927) ; d’ailleurs pour lui, quand le processus refroidit au point de se figer, il le « réchauffe » en invitant le patient à se relaxer, lui permettant parfois certaines libertés agies. Dès lors, peuvent apparaitre « des doses gigantesques de quantités d’excitation sensible, dépourvues de représentations, coupées de la décharge motrice et de la pensée ». (S. Ferenczi, O. Rank, 1924)
En poussant plus loin cette logique, on peut penser que loin de s’arrêter à une psychose passagère ou à des actings de transfert auxquels l’analyste répond par des actes, la fréquentation de la répétition traumatique peut atteindre des proportions fatales. Ferenczi, comme il le laisse entendre dans son Journal clinique, a lui-même payé de sa vie cette « chasse au trauma », trauma vécu et non interprété par Freud quand il le fallait : le 2 septembre 1932, quelques mois avant sa mort, il écrit : « Ai-je le choix entre mourir et me réaménager – et ce à l’âge de 59 ans ? » (1932, p. 284).
Dans le même texte qui clôt son Journal clinique, Ferenczi parle du choix entre mourir ou se réaménager après avoir décidé à prendre position sans la protection de Freud ; son courage de ne pas suivre le Maître et le lien qu’il en fait avec la maladie qui lui a coûté la vie, il le dit en ces termes : « Dans mon cas, une crise sanguine est survenue au moment même où j’ai compris que non seulement je ne peux pas compter sur la protection d’une “puissance supérieure”, mais qu’au contraire, je suis piétiné par cette puissance indifférente, dès que je vais mon propre chemin – et non le sien. » Après l’évocation de son sentiment d’abandon par quelques collègues, il écrit : « Une certaine force de mon organisation psychologique semble subsister, de sorte qu’au lieu de tomber malade psychiquement, je ne peux détruire – ou être détruit – que dans les profondeurs organiques. » (S. Ferenczi, 1932)
Un développement de M. de M’Uzan sur la « destruction organique » peut nous fournir les bases d’une plus ample compréhension de la position de Ferenczi sur le sujet. Dans l’un de ses articles, il écrit :
« Que l’excès de “quantité d’excitation” soit constitutionnel, ou bien dérive d’une incapacité de l’appareil psychique à l’élaborer, par un symptôme mental, le sujet se trouve quasiment condamné à mettre en œuvre une solution perverse, un symptôme somatique ou bien des réactions comportementales. La somatose équivalant à un acte peut donc être identifiée à une défense désespérée, débordant les capacités physiologiques de résistance dont dispose l’organisme et, pourtant létale. Ainsi, on mourrait du fait de la défense mise en œuvre pour survivre plutôt que d’un obscur projet pulsionnel. » (De M’Uzan, 1973).
Je vous fais part aussi d’une remarquable analyse de la maladie de Ferenczi, faite par Jean Guillaumin. Cette analyse montre que malgré la grande capacité d’élaboration psychique et théorique chez Ferenczi, capacité supposée déjouer autant que faire se peut, la solution d’une maladie somatique, un clivage s’ouvrait de plus en plus entre le « nourrisson savant » qu’il était, et l’enfant terrible qui voulait à tout prix prouver la pertinence de ses points de vue, malgré leurs excès et quitte à pousser la technique analytique dans des mesures intenables.
Sur la maladie organique de Ferenczi, et se risquant à schématiser, Guillaumin s’interroge en posant trois hypothèses possibles :
A. Ou bien Ferenczi est tout simplement mort d’une maladie par ailleurs incurable en dépit du profond travail interne, d’ordre auto-analytique auquel il se livrait.
B. Ou bien c’est la menace et l’approche de la mort qui l’ont mené dans les derniers temps à des prises de conscience remarquables […]
C. Ou bien enfin c’est l’intense et obsédante activité auto-analytique qu’il avait alors qui a agi de quelque façon sur la détérioration de sa santé, soit par fatigue, soit par un effet plus ou moins spécifique sur ses immuno-défenses, favorisant et précipitant l’issue fatale.
C’est cette dernière hypothèse que retient Guillaumin, en se posant la question suivante : " Comment concevoir que la réunification mentale de ses clivages, au lieu de le protéger des effets de ses conflits actuels et de ses déboires relationnels, en fortifiant son moi, ait été à quelque égard la cause, ou une importante cause auxiliaire de sa perte ? "
L’explication qui viendrait d’abord à l’esprit serait celle qui stipule que l’éclairage auto-analytique, qui est une activité psychique « interne », se serait allié et comme confondu, en lui donnant du coup une grande violence surmoïque persécutoire et destructrice, avec le refus et le jugement de désaveu et de rejet jusqu’ici plus secret de Freud sur les expériences de Sándor : que ce soit son expérience clinique subversive ou ses positions théoriques qu’il s’apprêtait à rendre publiques, notamment sa conférence sur la confusion de langue entre les adultes et l’enfant ; le langage de la tendresse et de la passion. Ici, le rejet de Freud se serait confondu avec son rejet de lui-même. Le destin de Ferenczi aurait donc été « réglé » et interrompu par la mort, via une somatisation. Somatisation produite, sinon aggravée par son rapport avec le cadre de Freud et son désir éperdu de lui prouver l’efficacité de ses positions.
Citant Raymond Cahn, Guillaumin dit que les aventures techniques de Ferenczi traduisent une sorte de procès contre Freud : « une querelle toute intime, amoureuse, reprochante et violente, agressive et auto-agressive, œdipienne mais avec de forts coefficients narcissiques : une querelle transférentielle, un procès intenté à Freud. »
Il est donc naturel qu’une impasse dans le lien conduise à une solution… je dirais une solution/non solution : un vécu transférentiel intense – propre à être interprété –, mais vécu dans le réel d’une relation d’amitié scientifique – situation non interprétable.
Passons à un autre terrain d’investigation du rapport psyché/soma, terrain inauguré avec les théorisations du groupe de l’investigation psychosomatique de l’École psychosomatique de Paris.
L’École psychosomatique de Paris
Avec l’École Psychosomatique de Paris, c’est le temps de l’intégration du somatique dans la conception psychanalytique. Ce que les pionniers de cette École ont tenté, c'est concevoir les manifestations somatiques comme relevant de la même juridiction psychanalytique que les manifestations d’ordre psychique, en appliquant les registres topique, économique et dynamique au symptôme somatique (C. Smadja, 2008). Il n’y a plus de séparation radicale entre le domaine psychique (qui relève de la psychanalyse) et le domaine somatique (qui relève de la physiologie et la médecine).
« Un malade psychosomatique, est défini comme un malade chez qui l’on peut reconnaître, de façon plus ou moins discrète ou plus ou moins bruyante, des troubles mentaux ». Pour P. Marty, « on dira donc qu’un malade est psychosomatique lorsqu’on établira la relation précise qui existe entre sa situation conflictuelle et sa maladie […] et cela jusque dans la forme même de cette maladie. » (C. Smadja, 2008)
Pierre Marty, Michel Fain, Michel de M’Uzan et Christian David essaient de sonder, dans la relation du malade psychosomatique avec le psychanalyste psychosomaticien les données cliniques, mentales et sensori-motrices (mimiques, manifestations gestuelles, agitations, tremblements, contracture…), afin de dégager des liens plus ou moins constants entre la symptomatologie somatique et les caractéristiques du fonctionnement mental ; dégager de nouveaux ensembles relationnels que ceux bien connus des névroses, psychoses et perversions, et des types relativement nouveaux de personnalité.
Les constantes et des invariants de personnalité qu’ils ont pu trouver : dans l’entretien, la pauvreté du dialogue qui a souvent besoin d’être relancé, ranimé, une inertie qui menace la poursuite de l’investigation, et plus généralement, un fonctionnement mental connu pour ses caractéristiques précises :
- La pensée opératoire, pensée automatisée, sans relation décelable avec des fantasmes inconscients. Pensée pragmatique, concrète, impersonnelle avec surinvestissement du factuel ;
- L’inhibition fantasmatique ou inhibition représentative de base : absence ou réduction de la vie fantasmatique et des rêves, reproduction des objets et des situations perçues – néanmoins et parfois, émergence pulsionnelle brutale, non élaborée des processus primaires, qui surgit ;
- La réduplication, perception d’autrui, stéréotypée, selon une image approximative de soi-même, dépouillée de traits personnels véritables.
Le fonctionnement mental
Je ne m’étendrai pas plus, sur la description clinique du fonctionnement mental souvent retrouvé chez les patients atteints de troubles psychosomatiques, mais m’arrêterai un peu sur l’utilisation, répandue depuis les théorisations de l’École psychosomatique de Paris, de l’expression fonctionnement mental. Nous l’utilisons assez souvent pour décrire la marche, les mouvements et les processus psychiques mais le terme fonctionnement a le mérite, depuis les débuts de son utilisation, de montrer si un mouvement psychique est fonctionnel ou non… s’il a une fonction dynamique précise, et s’il remplit un travail d’élaboration dans le psychisme. Définition qui ressemble comme deux gouttes d’eau à la définition freudienne de la pulsion, décrite comme une poussée, comme « le représentant psychique des excitations issues de l'intérieur du corps et parvenant au psychisme, comme mesure de l'exigence de travail qui est imposé au psychique en conséquence de sa liaison au corporel ». C’est donc bien de fonctionnalité dont il s’agit quand on parle de fonctionnement psychique, fonctionnalité en mal de liaison et de mouvement, dans les maladies psychosomatiques.
Il faut préciser que les troubles psychosomatiques n’ont pas lieu seulement au sein de ces structures spécifiques de personnalité, mais qu’elles peuvent constituer comme des noyaux défensifs ponctuels et occasionnels au décours d’un processus en marche : certaines périodes d’une vie ou des moments précis d’un processus analytique. Le cas de Ferenczi, malheureusement extrême, nous en donne un précieux exemple.
Avant de clore ce chapitre, quelques mots sur la différence entre symptôme hystérique et symptôme psychosomatique.
Je commence par cet adjectif un peu provocateur qu’on attribue au symptôme psychosomatique : on dit qu’il est « bête » ; sans doute pour le différencier de la surdétermination symbolique dont se vante le symptôme hystérique. Le symptôme hystérique est toujours en lien avec un fantasme sexuel refoulé, un conflit acharné dont il est la commémoration, alors que le symptôme psychosomatique est défini comme l’effet, sur le corps, d’un défaut de fantasmatisation, d’un défaut de mentalisation – il serait donc bête.
Le symptôme psychosomatique est comme un procédé de cimentation, de nouage qui tente de préserver l’organisme, de prévenir un effondrement psychique, plus en lien avec les pulsions d’auto-consevation qu’avec les pulsions sexuelles. Pour P. Marty, le déclenchement et l’entretien des somatisations est « régulièrement en rapport avec la rupture d’investissements affectifs importants pour l’individu en cause, [elles] dépendent de déséquilibres économiques de divers ordres homéostatiques (immunologie par exemple) ».
Sur le symptôme de conversion hystérique, Marty dit qu’il consiste en une régression partielle, dans la mesure où il ne modifie que partiellement l’organisation mentale de l’individu ; et que si l’on considère que la représentation refoulée dans l’hystérie constitue une zone muette, le reste du fonctionnement mental demeure la plupart de temps convenable.
J’ajouterai que le symptôme hystérique est une commémoration symbolique du traumatisme ; le symptôme psychosomatique est le traumatisme corporéisé, le traumatisme en image, halluciné, qui fait retour dans le soma. C’est toute la nuance entre le règne de la représentation et celui de l’hallucinatoire qui est ici en jeu.
* * * *
De clinique, je ne serai pas très généreux aujourd’hui en raison du souci de confidentialité. Mais je dirais que dans ma pratique, j’ai pu témoigner de manifestations psychosomatiques, voire même de l’éclosion de maladies somatiques dont on peut statuer le lien, dans un après-coup avec l’état régressif pendant lequel elles ont apparues. Dans tous les cas de figures de mon expérience, ces manifestions avaient comme invariants, non un défaut structurel de mentalisation (comme ça pourrait être le cas dans certaines organisations), mais, qu’on l’admette ou pas, une désignation, voire une dénonciation directe par le symptôme – dans l’actuel du transfert – d’époques de la vie de l’analysant où quelque chose d’un réel traumatique – forclos de la représentation – a pu se passer. Quelque chose donc, non encore, ou précairement symbolisé, qui a pu avoir lieu à un moment donné de l’évolution somato-psychique.
Par exemple, un organe qui sort de son silence par une manifestation maladive plus ou moins bruyante, et dont le patient se rend compte de la parenté – au fil de ses associations – avec la même maladie qu’il a pu avoir à un âge précoce ; avec, curieusement et presque systématiquement, un événement psychique qui noue le tout : une séparation, une absence prolongée, un secret fermement verrouillé, le tout enrobé d’une grande part de culpabilité inconsciente déniée, forclose, chez l’un des parents.
Roger, 40 ans, souffrant d’un asthme bronchique dont il s’est débarrassé au cours de sa cure analytique, après un accroissement sensible du symptôme, le rattache à une bronchite aigue qu’il a eue à l’âge de 8 ans, lors d’une absence prolongée de ses parents à l’étranger. Vers la fin de son analyse et dans une conversation avec sa mère, elle lui raconte qu’alors qu’il avait 6 mois, elle s’était endormie en le berçant sur ses jambes, en plein hiver, sans se rendre compte qu’il avait laissé tomber sa couverture.
En préparant cette conférence, je me souviens d’un article de G. Szwec qui, à mon étonnement, traite du même exemple en évoquant le ratage de la psychisation du corps chez certains bébés qui cherchent à se passer prématurément de leur mère, en réglant eux-mêmes leur homéostasie (autorégulation d’un organisme quel que soit le milieu extérieur). Il donne justement l’exemple de ce qui se passe quand une couverture tombe !
Je le cite :
« J’ai déjà parlé du très jeune bébé qui a froid parce que sa couverture est tombée. Il a deux façons de rétablir son homéostasie : soit il se réchauffe parce que sa mère lui remet cette couverture, soit elle ne le fait pas, mais il s’agite, crie de plus belle, et fait ainsi remonter sa température (Tronick).
« Je trouve qu’il y a, ici, matière à réflexion sur des frayages qui peuvent se constituer à la limite du somatique et du psychique selon les réponses de l’objet. On peut supposer que la propension à rechercher prématurément l’autosuffisance et le désengagement objectal est conditionnée par des expériences très précoces, vécues alors même que le moi et l’objet ne sont pas encore différenciés. Même lors du simple refroidissement d’un bébé, il y a, me semble-t-il, en germe, toute une évolution qui concerne le passage de l’instinct de conservation à la pulsion. » (G. Szwec, 2010)
Revenant à l’exemple de l’analysant en question, que sa mère lui raconte cet incident, permet d’imaginer que pendant le temps où il était dé-couvert, il avait dû se débrouiller seul, tout fragile qu’il était ; plus encore : que sa mère le lui raconte 40 ans après, montre la préoccupation, l’inquiétude et la culpabilité auxquelles elle a dû faire face, états mentaux qui ont dû organiser son angoisse par rapport à la pathologie somatique ou psychosomatique ultérieure de son fils et sceller la nature du symptôme choisi par l’appareil somato-psychique de Roger.
Je termine par une belle citation de Ferenczi qu’il évoque dans l’une de ses dernières notules de 1932 : « Les souvenirs désagréables continuent à vibrer quelque part dans le corps ».
Références
Ferenczi S. (1927), Le problème de la fin de l’analyse, Psychanalyse 4, Œuvres complètes, 1927-1933, Payot, Paris, 1982.
Ferenczi S. (1932), Journal clinique, Payot, 1985.
Ferenczi S. et Rank O. (1924), Perspectives de la psychanalyse, Sándor Ferenczi, sous la dir. de T. Bokanowski, K. Kelley-Lainé, G. Pragier, Paris, PUF, « Monographies de la RFP », 1995.
Freud S. (1924 [1923]), Court abrégé de psychanalyse, Résultats, idées, et problèmes, II, trad. fr. J. Altounian, A. Bourguignon, P. Cotet, A. Rauzy, Paris, PUF, 1985 ; OCF.P, XVI, 1991 ; GW, XIII.
Freud S. (1928 [1927]), Dostoïevski et la mise à mort du père, Résultats, idées et problèmes, II, trad. fr. J.-B. Pontalis, Paris, PUF, 1985 ; OCF.P, XVIII, 1994 ; GW, XIV.
Freud S., Zweig A. (1968 a [1927-1939]), Correspondance 1927-1939, trad. fr. L. Weibel, Paris, Gallimard, 1973.
Guillaumin J. (1995), De contre-transfert inconnu ou Ferenczi, la mort et l’auto-analyse in Sándor Ferenczi, Paris, Puf, « Monographie de la Rfp », p.
Hautecouverture M. (2003), Interview par Claude Smadja et Gérard Szwec in La question de l’immunité, Revue française de psychosomatique, Paris, PUF.
M’Uzan M. de (1973), Genèse du symptôme somatique ; Trois hypothèses théoriques et suivi d’une cure in Cliniques psychosomatiques, sous la dir. de G. Le Gouès, G. Pragier, Paris, PUF, « Monographies de la RFP », 1997.
Smadja C. (2008), Les modèles psychanalytiques de la psychosomatique, Paris, Puf, Le fil rouge, 241 p.
Szwec G. (2010), Défaillance de la psychisation du corps chez le bébé non câlin, Rfp, t. LXXIV n° 5, p. 1687-1691.