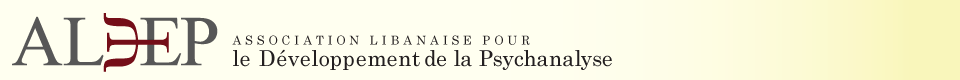Le deuil
Une histoire de fantômes
(Conférence prononcée le 16 février 2012 dans le cadre des conférences de l'Association Libanaise pour le Développement de la Psychanalyse.)
L’homme, explique Sir J. Eccles, a subi le plus grand traumatisme de son existence lorsqu’il a découvert la réalité de la mort, révélation concomitante à l’acquisition du langage (J. Eccles, 1992). D’ailleurs, l’enfant ne découvre sa propre mort que quelques années après avoir acquis le langage. L’effet traumatisant de la mort aurait selon Freud, deux explications.
D’une part, l’homme sait qu’il est mortel, mais ne croit pas à la réalité de ce savoir, car il n’a aucune représentation possible de sa propre mort, même s’il croit à la mort de l’autre. Les deux situations sont radicalement différentes.
D’autre part, cette représentation est tout à fait spéculaire, alors que dans la première, même s’il peut se représenter sa propre mort, il est toujours là, vivant, en tant que spectateur. « C’est que notre mort ne nous est pas présentable et aussi souvent que nous tentons de nous la présenter, nous pouvons remarquer, qu’en réalité, nous continuons à être là en tant de spectateur », écrit Freud (S. Freud, 1915).
Le comportement de l’homme depuis l’origine, ses croyances religieuses et mythiques montrent qu’il dénie la mort et reste convaincu dans son inconscient de son immortalité. Ce qui ne veut pas dire que ce savoir n’existe pas dans l’inconscient, mais qu’il échappe dans sa représentativité à la temporalité, condition nécessaire à l’échéance de la mort. C’est un réel impossible qui résiste à toute spéculation imaginaire ou intellectuelle, car le sujet se trouve exclu devant toute représentation. Le langage se heurte à un obstacle à propos duquel Maud Mannoni parle de « nommer l’innommable ». Chaque fois, donc, qu’un être humain est confronté à ce réel qui s’avère impossible, il est ébranlé dans sa certitude et se réfugie dans des positions ou des attitudes de plus en plus régressives.
En cela, mon but n’est pas d’écrire sur la mort mais plutôt, sur la vie des morts, qui viennent habiter le corps et l’esprit des vivants. Je vais donc essayer de vous communiquer ce que je pense de ces fantômes qui nous habitent, de cette étrange histoire d’amour et de mort qui fait du corps de chacun le siège de ce qui n’est plus.
Pour l’inconscient, toute mort est peut-être un crime et tout survivant peut-être un criminel en fuite, poursuivi par le désir du mort. L’objet de la disparition, l’objet de ce désir est bien cette présence spectrale que l’endeuillé commence par ne pouvoir séparer de lui.
A préciser toutefois, qu’un état de deuil peut-être déterminé non seulement par la mort réelle d’un proche, mais aussi par la perte d’un objet avec lequel une relation étroite a été brisée (états amoureux, perte des objets infantiles, de l’objet œdipien chargé d’ambivalence ou encore mort d’une amitié, etc.) La liste est longue.
Je ne vais pas m’attarder sur les deuils qui sont indispensables à notre survie, mais retiendrai celui qui désigne à la fois le fait de perdre un être cher et la réaction à cette perte. Cette réaction se caractérise par un affect douloureux, une suspension d’intérêt pour l’extérieur, une inhibition.
Ph. Ariès rapporte dans son livre L’homme devant la mort (Ariès, 1985), un passage de l’œuvre de Tolstoï, Sur les trois morts : « L’attitude ancienne où la mort est à la fois, proche, et familière, s’oppose trop à la nôtre où elle fait si grande peur que nous n’osons plus dire son nom. C’est pourquoi, quand nous appelons cette mort familière la mort apprivoisée, nous n’entendons pas qu’elle a été ensuite domestiquée. Nous voulons dire au contraire qu’elle est aujourd’hui devenue sauvage alors qu’elle ne l’était pas auparavant... »
Cette difficulté extérieure se joint à des obstacles, de nature structurale, que, tout un chacun, recèle en lui. Fait, que l’homme trébuche dans ce travail psychique de la perte avant même d’accéder à un travail de deuil « normal ».
Et pourtant, le deuil est le propre de l’homme. Expérience toujours singulière, formes multiples, les deuils mobilisent chez l’être humain des forces venues du plus lointain de son histoire personnelle et collective. Forces constructives et forces destructives, mouvements de vie et mouvements de mort, les deuils enrichissent, démantèlent, immobilisent ou tuent notre vie psychique, de façon passagère ou durable, selon les voies empruntées pour y faire face, c’est-à-dire selon qu’un travail psychique accompagne ou non le deuil.
Je partirai de mes propres questionnements sur le travail psychique du deuil, pour me pencher ensuite sur la notion de survivance, qui s’avère être un paradigme opérant, afin d’appréhender l’énigme du deuil. Enfin dans une dernière partie, j’étendrai ma réflexion à une autre figure reliant l’endeuillé à la vie ou plus exactement : comment l’aider à retrouver du vivant en soi ?
Le travail psychique d’un deuil
Pour Freud lui-même, comme Œdipe devant le sphinx, « le deuil est une énigme, un phénomène qu’on ne tire pas au clair et qui ramène à des choses obscures » (Freud, 1917 [1915]). Obscurité qui plonge l’énigme dans un questionnement portant sur la notion de temps psychique : le temps qui stagne, les frontières qui deviennent floues entre sujet et objet ; le fantasme, l’hallucination, la forme et la déformation d’une image : qu’est-ce qu’on conserve et qu’est-ce qu’on transforme ? L’énigme du deuil apparaît alors comme une énigme de l’inconscient. « Est-ce parce que pour l’inconscient la mort n’est pas représentable ? » s’interroge L. Laufer (L. Laufer, 2006).
Perdre un être cher, et vivre le deuil, c’est affronter le problème de la représentation de ce qui justement ne se représentera plus jamais dans la réalité. Or, si la mort est irreprésentable, il semble que ce soit le mort qui fasse sans cesse retour, et Freud le pointe sous la forme du double, de l’inquiétante étrangeté, du fantôme, du spectre.
Freud répétait jusqu’en 1926, à quel point le deuil est difficile à comprendre, tout particulièrement son caractère douloureux : « Nous ne pouvons même pas dire par quels moyens économiques le deuil accomplit sa tâche » (S. Freud, 1917 [1915]) 6. Et si pour lui, la question du deuil est réactualisée au moment de la mort de son père en 1896, point de départ de son auto-analyse, Totem et Tabou (1912) est le premier texte où il parle explicitement de la mort et du deuil. Dans Deuil et Mélancolie, écrit par ailleurs un an après Pour introduire le Narcissisme (1914), il semble poursuivre sa recherche sur le narcissisme qui établit une différence essentielle entre le deuil dit normal (où la perte est reconnue) et la mélancolie, dite deuil pathologique (où la perte n’est pas reconnue).
Le travail de deuil serait donc l’énigme centrale devant laquelle Freud s’en remet au « verdict de la réalité ». L’épreuve de réalité a montré que l’objet aimé n’existe plus et édicte l’exigence de retirer toute la libido des liens qui la retiennent à cet objet. » 7 (S. Freud, 1917 [1915], p. 148)
Alors que la vie psychique se confronte, se heurte à la réalité, « l’existence de l’objet perdu se poursuit psychiquement ». Accélérer le temps de deuil en viendrait à porter atteinte à la vie psychique même.
La séparation passerait donc par le surinvestissement. Il ne s’agit pas d’une distance, d’une exclusion, mais d’une intimité : voir au plus près de son fantasme, quitte à déformer l’objet disparu, quitte à se déformer soi-même. L’énigme du temps fait écho à l’énigme de l’objet. Comment comprendre la douleur, la souffrance ? Quel est donc l’objet du deuil ? Qui perd qui ? Qui perd quoi ?
C’est sans doute le sens de l’interrogation de Freud : « Le malade sachant sans doute qui il a perdu mais non ce qu’il a perdu en cette personne » (S. Freud, 1917 [1915], p. 149) 8.
La perte de l’objet est une menace parce qu’elle emporte un complément entre toi et moi, un petit bout de soi, selon Jean Allouch (J. Allouch, 1995) 9. Le mort emporte une partie de l’endeuillé, son désir, son regard, sa voix. On est en deuil de ce que l’autre en mourant dérobe de soi-même et emporte avec lui.
L’endeuillé, selon la tradition freudienne, perd un petit bout de lui, ce qui donne à la théorie du narcissisme et de la mélancolie son assise. La libido se retire sur le moi. Perdre l’autre, c’est perdre un bout de soi. Le deuil est alors un circuit d’échange. Le mort laisse quelque chose au vivant. Ce quelque chose, précise Freud, peut faire l’objet de la maladie de l’endeuillé.
J. Lacan précise dans son séminaire sur l’angoisse : « Dès que ça se sait, que quelque chose du réel vient au savoir, il y a quelque chose de perdu, et la façon la plus certaine d’approcher ce quelque chose de perdu, c’est de le concevoir comme un morceau de corps. » (J. Lacan, 1962-1963) 10
De plus, la disparition de l’autre fait de l’endeuillé non pas un corps séparé mais une image indistincte, un effacement de soi. Le deuil était l’événement, l’expérience même de la formation d’un temps autre, radicalement étranger à soi. Étranger à soi par la non-distinction même.
Que reste-t-il alors de soi-même ? C’est toute la question de l’énigme du deuil que de retrouver en soi des traces effacées.
L’endeuillé, donc, ne perd pas seulement l’objet, il perd jusqu’à l’histoire et le temps de l’objet, c’est-à-dire un temps et une l’histoire l’identifiant.
Comme si l’endeuillé devait traverser une expérience temporelle et corporelle radicalement autre afin de laisser surgir, se former ou re-former l’image, le visage du disparu.
Aujourd’hui, l’expression « faire son deuil », employée indifféremment pour une personne disparue, un travail, une maison, un chien, en s’inscrivant dans l’idéologie du résultat à obtenir malmène l’énigme du deuil. D. Lagache, dans un numéro de la R. F. P., relève le caractère insolite de la douleur du deuil (D. Lagache, 1938).
De fait, il y a dans cette idéologie de l’effort, de la production, de la gestion, une position adaptative, voire répressive évidente : « Seul le moi peut affronter cette épreuve de réalité. Non seulement il peut – sous peine de tomber dans un deuil pathologique, mais il doit ! Ainsi, l’affirme Freud ; le bon deuil doit amener le moi à renoncer à l’objet en déclarant l’objet mort, il offre au moi la prime de rester en vie. » (S. Freud, 1917 [1915]).
Cependant, pour arriver à cette formule il faut comprendre la question de la survivance, de ce qui subsiste en nous de l’objet perdu. Alors comment vivent les images du disparu dans la vie psychique de l’endeuillé ? Comment survient-il à la mémoire de l’endeuillé ? Comment retrouver un « quelque chose », un reste de l’objet perdu lorsque la mémoire semble l’avoir effacé ?
La question de la survivance ou que reste-t-il d'une chose disparue ?
La question de la survivance nous engage dans un processus de recherche pour appréhender l’énigme du deuil telle qu’elle est posée par Freud et qui s’articule autour de cette proposition déjà évoquée : L’endeuillé sait qui il perd mais non « ce » qu’il perd en la personne disparue.
Revoir le disparu dans un rêve, croire l’apercevoir à un coin de rue, ouvre à la rencontre avec les fantômes psychiques. Ce retour d’une forme à la fois proche et lointaine crée l’étonnement, l’inquiétude, l’angoisse, voire la déformation d’un temps hors temps anachronique. En effet, la survivance des formes psychiques ouvre à l’association d’images, précédant l’association de mots ou d’idées. Car avant de pouvoir parler du fantôme, il faut l’avoir rencontré. C’est, en effet, dans le corps que peut se rencontrer le fantôme.
Cette rencontre (entre corps et psyché) est précisément particulière. Pourquoi ? Parce qu’elle défait la logique du distinct, du discernable. Son paradoxe tient en ce qu’elle s’inscrit dans la constitution d’un espace psychique par la « destruction » de l’espace entre le sujet et l’objet. La question qu’elle pose est celle de l’accession à une subjectivité tout en effaçant la distinction sujet-objet. C’est en cela que la notion de survivance, qui détruit un espace de distinction, convoque les notions de fantôme, d’hallucination, d’indistinction, entre les formes.
Ainsi, on peut entendre la notion de survivance comme le mouvement de va et vient, de retour du fantôme, et ce retour du fantôme entraîne de la douleur, et des symptômes. L’angoisse qui accompagne ce retour est nécessaire à la réouverture du trauma dans la cure.
Ce temps du fantôme, ouvre sur un espace du fantasme. Saisir ce moment de retour des fantasmes, qui n’est qu’un temps de passage vers la présence fantasmatique à soi-même.
L’histoire dans la survivance n’est pas linéaire, mais s’élabore en temps et contretemps, par anachronismes et diachronismes (après-coup). C’est le passé anachronique et présent réminiscent, selon l’expression de Pierre Fédida (P. Fédida, 1985). 13.
Alors un revenant, est-ce un corps, est-une image ? Se référant à Totem et Tabou en 1914 dans l’Histoire du mouvement psychanalytique, Freud souhaite marquer l’importance de la question de l’image, de la trace, de l’inscription, dans la psyché. L’expérience du deuil serait donc une expérience de l’image et de la vocation à ouvrir l’imaginaire. C’est pourquoi la survivance, l’« après-vivre » des images est au cœur même de l’expérience du deuil.
Qu’est-ce qu’un fantôme ?
Comment faire apparaître les fantômes afin d’en saisir l’énigme ?
Le fantôme est une forme qui traverse le temps et l’espace psychique. Comme trace ou forme indistincte du corps, le fantôme n’a que faire du temps chronologique, généalogique. Il est bien trop « passe-muraille » pour se laisser enfermer en un lieu, il peut d’ailleurs, en certains cas ne pas avoir de lieu…
L’histoire de fantômes ne porte pas seulement sur les objets à contempler mais sur des tensions, des écarts, des analogies et des contradictions.
Ce n’est pas donc l’objet de la mémoire qui compte mais le rapport, la tension que cet objet de mémoire entretient avec un autre objet.
Le fantôme, et l’accès à la mémoire qu’il permet, est la condition d’apparition, « de réveil d’une suite d’images ». Accéder à sa propre mémoire, est une épreuve de soi qui sera la traversée de l’angoisse, ouvrant sur un dessaisissement de l’objet perdu.
C’est un temps de transformation de soi, c’est-à-dire une perte d’un bout de soi. L’expérience du deuil est donc l’expérience de la survivance des images en ce qu’elle ouvre un espace psychique aux fantômes, et cet espace est aussi l’espace du rêve ; l’ouverture des images du rêve comme si convoquer les morts par la parole revenait à effectuer le travail du deuil par le travail du rêve.
Se souvenir : lieu de conflit
Dans le bloc-notes magique, Freud confirme que « rien ne se perd dans la vie psychique » (S. Freud, 1925 [1924]). Alors, si rien ne se perd, c’est que la mobilité et la plasticité opérant un mouvement psychique permet la transformation et rend toute circulation pulsionnelle possible. C’est pourquoi l’expérience temporelle du deuil ne saurait se concevoir sans la survivance, trace mnésique en mouvement, force énergétique modifiant sans cesse l’appareil psychique.
Il s’agit de tracer le cadre d’un miroir brisé, afin que l’endeuillé puisse se réinscrire dans son histoire. Le mélancolique réside dans un temps qui ne passe pas et où la mémoire ne permet pas l’oubli. La plasticité nécessaire n’est-elle pas disponible ? Cette plasticité psychique signifie à la fois suppression et conservation.
La mémoire est plastique en ce qu’elle retient et oublie en même temps, c’est-à-dire qu’elle a une capacité de créer une forme au-delà de la forme elle-même. La forme modelée ouvre sur l’imaginaire, capacité à créer une fiction porteuse de parole. Il y a donc du corps, de l’image et de la symbolisation.
Mais comment conserver la mémoire et faire du nouveau ? Comment conserver et modifier à la fois ? Ce mouvement dialectique de conservation et de modification relève de l’aspect conflictuel de la mémoire. L’endeuillé veut conserver quelque chose de l’objet disparu et, en un même mouvement, accéder à sa propre mémoire modifie l’objet disparu. En effet, l’endeuillé ne veut pas se souvenir qu’il a pu souhaiter la mort de l’objet perdu avant même sa disparition. C’est à ce conflit là que l’expérience du deuil expose.
Lorsque la réalité du traumatisme rencontre dans son horreur réelle le fantasme, c’est le lieu même du conflit infantile, c’est-à-dire la réserve fantasmatique de la vie psychique qui est détruite.
De plus, se souvenir de l’autre c’est aussi revenir à soi-même, se rencontrer dans ses propres souffrances. Le travail de mémoire dans le deuil est aussi ce travail de souvenir de soi, en tant que sujet désirant : qu’étais-je pour l’autre ? Se rappeler de soi au moment où vivait le mort, au moment de l’événement qui a fixé le temps. Comme si l’endeuillé, pour ne pas se souvenir de la mort de l’autre et du désir qui pouvait l’accompagner, avait effacé tous ses souvenirs. Alors, lorsque les souvenirs reviennent, les fantômes apparaissent. C’est pourquoi la douleur peut être extrême… La douleur participe au développement de l’organisme. Le deuil est une force et une forme qui mettent l’organisme en mouvement. Comme mouvement de transformation et de déformation, la douleur serait dans le cas de l’expérience du deuil, le mouvement de la plasticité psychique.
« Faire » le deuil, ne serait-ce pas alors se situer dans cette dialectique conflictuelle, retrouver même ce qui fait la lutte interne ? C’est en cela que le deuil remettrait en mouvement le désir, dans le sens où le désir est le lieu même du conflit psychique. Le conflit de la mémoire et l’énigme de la vie psychique passe par cette formule : que suis-je pour l’autre ? Ce que j’étais pour l’autre n’est plus, et je ne suis plus l’objet de son manque. Je ne manque plus à l’autre. Je suis donc moi-même manquant, faillible, inachevé.
Enfin, comment continuer ?
Selon G. Bayle (Ph. Jaeger et C. Rueff-Escoubès, 2006, Entretien avec Gérard Bayle) l’endeuillé a besoin dans un premier temps d’un clivage d’urgence, d’un colmatage psychique, pour se protéger de l’impact de sa souffrance traumatique. Les gens, la communauté, créent ce colmatage psychique, ce clivage, qui doit être respecté le temps qu’il faut. Colmatage considéré comme aide parce qu’il vient de l’entourage, des groupes et, traditionnellement, des religions, qui écartent le doute de la pensée rationnelle pour proposer des croyances relevant du déni et de l’idéalisation. Ce colmatage psychique a une fonction antalgique d’urgence. La communauté doit faire corps. Le deuil met le monde en mouvement. Il inspire ce jeu fantasmatique – désignifiant des attitudes et rituels du deuil – qui crée la fête de la mort. Le jeu offre la possibilité de symboliser l’absence, il ouvre à un espace de représentation et de métaphore. Ph. Ariès souligne que, si le deuil s’efface, c’est aussi sous la contrainte impitoyable du social qui refuse l’émotion de l’endeuillé, même si la réalité de la mort est admise. Par ce refus, la société efface la présence de la mort même, y compris ces manifestations de douleur… Réprimer les manifestations de douleur devient après coup traumatique pour l’endeuillé. C’est au moment de la répression de l’expression de l’endeuillé à l’endroit de l’objet perdu que se figurerait le trauma : interdit de voir, interdit de pleurer ou de rire, interdit de manger, obligation d’être triste. Toutes les prescriptions comportementales ou visibles anesthésient les mouvements de la vie psychique au moment du deuil.
Examiné sous cet aspect, le deuil apparaît comme une expérience métamorphique. Il s’agit pour l’irreprésentable d’avoir un lieu accueillant toutes les métamorphoses possibles, afin que l’événement puisse se dire.
Dans le dispositif transférentiel, quelque chose aura lieu, l’apparition d’un visage va créer de l’affect, créer le mouvement de l’affect, l’émouvoir au mouvoir. Le lieu psychique de sépulture devient le lieu d’une déposition, celui d’un corps et d’une parole. La parole est ce seuil mouvant de la paroi du tombeau : parler, c’est laisser se former un lieu qui donne forme au mourant et c’est prendre soin que celui-ci trouve le temps de s’approprier sa propre mort » (P. Fédida, 1996, p. 15).
Travail de deuil, travail de rêve, travail du transfert, ainsi se noue autour de la question de l’image du disparu, la possibilité de « voir disparaître sans disparaître soi-même, sans s’effacer soi- même ».
La clinique du deuil traumatique reviendrait donc à engendrer un lieu de sépulture qui ne soit pas une pierre tombale, un monument pétrifiant la mort autant que du vivant, mais un lieu qui remette en mouvement le corps autant que la parole.
Dans cette perspective, le cadre analytique et le transfert auraient comme enjeu clinique de mettre en place les conditions nécessaires à la remobilisation de la vie psychique de l’analysant.
La rencontre transférentielle est une situation psychique plastique ; elle donne de la respiration et ouvre les mailles parfois trop serrées de la théorie. « Psychologiser » les propos de l’endeuillé, en s’arrêtant à des théories préétablies, rigidifie la technique clinique du traumatique et exclurait l’écoute de tout dispositif transférentiel singulier. De ce fait, il ne suffit pas de se souvenir, il ne suffit pas de « verbaliser », comme on dit, de mettre des mots sur la douleur ; le déplacement s’opère par et dans le transfert. Ce que le deuil réveille s’inscrit dans le désir inconscient qui lui échappe. Ce qui se trace dans le deuil, c’est la disposition du désir du survivant pour le mort. Que la réalité fasse verdict, soit, le survivant est prêt à accepter, à renoncer ; mais ce qui fait la douleur, c’est le savoir révélé par la mort de l’autre (la haine ou l’amour, la vengeance ou la joie, le désir de l’avoir tué…)
Et c’est cet après-coup qui confère au deuil son caractère pathogène. C’est ce que révèle la mort de l’autre sur son désir qui crée, après coup, le traumatisme de l’endeuillé. Perdre l’autre ouvre à un savoir psychique sur la violence et la destruction. La violence faite à la personne qui vient de perdre un proche s’inscrit dans la résurgence de ses fantasmes de meurtre, ses vœux de mort. L’expérience du deuil permet d’ouvrir un passage aux fantasmes formés à l’endroit de l’objet perdu, de tracer les contours d’un désir. Et cette expérience de vérité ne se fait pas sans angoisse.
Toutefois, le travail analytique ne se réduirait pas à une normativité (il y a de bons et de moins bons deuils, des deuils normaux et pathologiques), mais à la mise en condition d’un espace psychique qui retisse les liens avec l’objet/sujet perdu, afin que la déchirure traumatique ne rigidifie pas la vie psychique et ne mortifie pas le survivant.
Ainsi comprise, la psychanalyse est pratiquée comme un art, l’art de construire un sujet mobile et non barbare.
En guise de conclusion
La solution du deuil n’est pas un laborieux travail mais un geste instaurateur d’abord de visibilités, fussent-elles hallucinées, puis de paroles quand les mots viennent produire la sépulture libératrice. Libérer les vivants c’est aussi libérer les morts de l’obligation de légitimer la vie des vivants. Survivre c’est inventer, c’est-à-dire qualifier l’oubli. Je termine par cette citation de Freud :
« Ce n’est ni l’énigme intellectuelle ni chaque cas de mort, mais le conflit de sentiment à la mort de personnes aimées et pourtant en même temps, étrangères et haïes qui a libéré la recherche chez les hommes » (S. Freud, 1915).
Références bibliographiques
Ariès Ph. (1985), L’homme devant la mort, Le temps des gisants, coll. Seuil, Points d’Histoire, t. 1.
Allouch J. (1995), Érotique du deuil au temps de la mort sèche, Paris, EPEL, 1995, 380 p.
Eccles Sir John (1989), Évolution du cerveau et création de la conscience, coll. Champs, Flammarion, 1994.
Fédida P. (1985), Passé anachronique et présent réminiscent. Épos et puissance mémoriale du langage, L’Écrit du temps, n˚ 10, Paris, Minuit, 23-45.
Fédida P. (1996), L'œuvre de sépulture, La fin de la vie, qui en décide ?, Paris, P.U.F, 11-17.
Freud S. (1915), Notre relation à la mort, in Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort, Essais de psychanalyse, trad. fr. A. Bourguignon, et A. Cherki, P. Cotet, Paris, Payot, 1989, OCF.P, XIII, 1988 ; GW, X.
Freud S. (1917 [1915]), Deuil et mélancolie, Métapsychologie, trad. fr. J. Laplanche, J.-B. Pontalis, J.-P Briand, J.-P. Grossein, M. Tort, Paris, Gallimard, 1968 ; OCF.P, XIII, 1988 ; GW, X.
Freud S. (1919), L’inquiétante étrangeté, L’inquiétante étrangeté et autres essais, trad. fr. A. Bourguignon, Paris, Gallimard, 1985 ; GW, XII.
Freud S. (1925 [1924]), Note sur le « Bloc magique », Résultats, idées et problèmes, II, trad. fr. J. Laplanche, J.-B. Pontalis, Paris, PUF, 1985 ; OCF.P, XVII, 1992 ; GW, XIV.
Jaeger Ph. et Rueff-Escoubès C., Entretien avec Gérard Bayle, Deuil et somatisations, Revue française de Psychosomatique, no 30, 2006/2, 63-77.
Lacan J. (1962-1963), Le Séminaire-Livre X, L’angoisse, Paris, Seuil, « Champ freudien », 2004.
Lagache D. (1938), Le travail du deuil : ethnologie et psychanalyse, Revue française de Psychanalyse, vol. 10, n° 4, Paris, PUF, 693-708.
Laufer L. (2006), L’énigme du Deuil, Paris, PUF, 217 p.
_______________
Figure en haut de page : Ara AZAD, Have I died and I don't know it?! A Century Through Specs, Artist's book, 1994, USA.