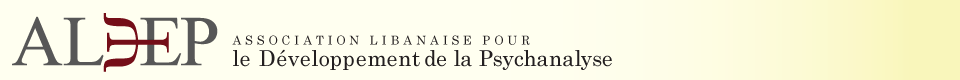Être, penser, créer :
Quand la guerre attaque le cadre et que le transfert contre-attaque
(Conférence prononcée le 15 mars 2012 dans le cadre des conférences de l'Association Libanaise pour le Développement de la Psychanalyse)
« Et la terre, et le fleuve, et leur flotte, et le port,
sont des champs de carnage où triomphe la mort.
Ô combien d’actions, combiens d’exploits célèbres
sont demeurés sans gloire au milieu des ténèbres
où chacun, seul témoin des grands coups qu’il donnait,
ne pouvait discerner où le sort inclinait… »
Corneille, Le Cid, Acte I, scène 3.
J’ai toujours été fascinée, lors de mes diverses rencontres avec des collègues psychanalystes étrangers, par leur capacité à se projeter dans l’avenir. Quand il y en avait un parmi eux qui me proposait un projet en commun, il était généralement surpris de m’entendre dire : « On verra… c’est à confirmer » ; il prenait ma réponse pour un faux-fuyant alors que j’avais montré au départ un enthousiasme passionné. Je me suis rendue à l’évidence que nous vivions différemment la projection dans le temps. L’un – lui – était dans la constance d’un temps rythmé par le prévisible, l’autre – moi – étant prise par l’imprévisibilité d’un espace-temps à la merci de l’inattendu traumatique – la guerre. Une guerre peut se déclencher à tout moment, quand elle n’est pas continue comme elle l’a été pendant quinze ans et demi. Comme si la guerre était ordinairement là et que nous vivions dans un traumatisme permanent, indéfiniment en sursis.
Mon propos n’est pas la clinique du traumatisme. Ni de la temporalité. Mais un questionnement sur le travail de l’analyste quand il vit dans un contexte où l’imprévu commande. L’impromptu qui vient du monde extérieur rend souvent sa tâche difficile, voire même incompatible avec les invariants de la possibilité d’une cure. Que devient le cadre analytique quand il est soumis à l’imprédictible ? Comment protéger l’invariance du cadre quand il est constamment attaqué ? Que se passe-t-il quand l’analyste et l’analysant sont pris dans une même situation traumatique ?
Nous avons vécu des états extrêmes, qu’il est impossible d’élaborer encore aujourd’hui. Faire l’inventaire de toutes ces circonstances spécifiques de l’attaque du cadre dans une conjoncture de guerre serait un projet illusoire. Mais partir de conditions réelles, vécues, rendrait le dessein accessible et réalisable. Emile, Paul, Nadine, sont trois patients avec lesquels j’ai vécu des situations extraordinaires, dues à la guerre, auxquelles il a fallu répondre. Tout de suite. Dans l’immédiateté d’une réalité qui n’attend pas.
Émile
Assise dans mon fauteuil de psychanalyste, j’entends au loin le brondissement des bombes. Emile me parle de son père, de sa mère, de ses fantasmes…
Le bruit des bombes se rapproche. Je le reconnais, comme tous mes concitoyens, à trois phases d’une succession de tonalité : au son de leur propulsion – appelé départ – qui se fait de plus en plus adjacent, au chuintement de leur passage quand elles sifflent en passant à proximité, et à l’écho de leur désagrégation au moment où elles atteignent une cible – appelé arrivée – en éclatant de plus en plus près. Je prends peur. Pour Emile. Pour moi. Pour les miens. Je pense à des membres de ma famille qui sont probablement sur les routes. J’ai peur pour eux. Émile me parle de ses fantasmes.
J’entends des éclats d’obus pulvérisés sur les murs de l’immeuble d’à côté, signe que les bombes tombent encore plus près. Il faut téléphoner pour m’assurer que ma famille est en lieu sûr. Émile me parle de ses fantasmes.
J’entends des éclats de voix qui viennent de l’entrée de l’immeuble et les pas des voisins qui dégringolent l’escalier pour rejoindre l’abri. Il faut peut-être y aller. J’entends Émile dire : « Rien ne peut m’arriver puisque vous êtes là », et il me parle de ses fantasmes.
Je ne l’écoute plus. Adieu écoute flottante, neutralité bienveillante, « matrice active » [1], processus de transformation… Plus rien ne m’importe désormais à part la réalité et ma responsabilité : Que faire d’Émile ? L’envoyer dans la rue ? Ce serait ignorer à mon tour la réalité extérieure et vivre cette « folie à deux » qui n’est plus mienne, qui n’est plus que folie à un seul personnage hallucinant la présence d’un autre qui n’est plus là ! Émile me parle de ses fantasmes.
Je n’étais plus là. J’étais prise par la perception de la réalité, la réalité traumatique, celle-là même qu’Émile déniait en ce moment. Il était pris par ses représentations internes qui le clivaient de la perception de cette réalité externe. Il était transporté par un transfert idéalisant sur l’analyste omnipotente, mère protectrice, contenante, sécurisante, que j’étais dans la continuité de son monde à lui, bien que moi je ne l’assurais plus. Il était entrainé par une névrose de transfert déterminée par ses quelques caractères délirants, « ne serait-ce que par le refus quasi psychotique d’intégrer quelque éléments de réalité » [2].
Il était emporté par une forme d’hallucination induite par la régression, heureusement rapidement arrêtée, aussitôt qu’il s’est rendu à l’évidence de l’épreuve de réalité une fois la séance terminée. Pas avant. Il a fallu attendre quarante-cinq minutes. Quarante-cinq longues minutes pour que le moi d’Émile sorte du monde hallucinatoire du rêve et du fantasme, et arrive enfin à distinguer l’hallucinatoire du perceptif, au moment où la réalité extérieure était ramenée avec toute sa sensorialité : il entendait les bombes maintenant. Il les entendait mais sans peur, parce que j’étais là et que je le protégeais me répétait-t-il. Si le déni de réalité n’était plus opérant puisque la fin de la séance le ramenait à toute la sensorialité de la perception d’un danger palpable, le transfert idéalisant, lui, continuait à fonctionner comme écran, comme défense d’un moi débordé face à une réalité difficile à métaboliser. L’illusion transférentielle fonctionnait comme protection entre lui et une réalité mortifère. L’inter-relation comme pare-excitation à un intrapsychique débordée. Je l’installais dans la salle d’attente bien protégée par les murs internes, au cœur de mon cabinet. Il a fallu lui offrir de l’eau, des sandwichs, une radio pour suivre les nouvelles… proposer ensuite un matelas pour passer la nuit ! Des éléments de survie, évidemment. Émile n’a pu partir que le lendemain matin.
Paul
Cela faisait maintenant quinze jours que les séances n’avaient pas eu lieu. Quinze jours que les bombardements n’avaient pas connu de cessation. Des bombardements intensifs, sans rémission. Alors qu’une des spécificités de la guerre du pays était son changement constant d’identité, sa discontinuité et son déplacement de régions en régions [3], cette fois c’était du continu. Toutes les régions étaient touchées.
Quinze jours donc que Paul ne pouvait plus venir à ses séances, alors qu’il passait par une phase de fragilité.
Je suis à mon domicile. En robe de chambre. Il est 9 heures du matin. La sonnerie se fait entendre. J’ouvre. C’est Paul que j’aperçois dans l’encadrement de la porte. Le teint terreux, livide. Je ne peux réprimer un mouvement de surprise. Il me dit qu’il a absolument besoin de me parler. Je pense au cadre, à sa constance, à ses invariants spatio-temporels… mais je pense aussi qu’il a mal et qu’il souffre ! Comment être empathique et demeurer analyste ? « Si l’empathie est nécessaire, penser reste indispensable. Penser en psychanalyste. » [4]
Je dois le recevoir. Mais où ? Dans le bureau de l’appartement il y a des matelas par terre, des parents étant réfugiés chez nous, notre maison étant dans un lieu moins exposé aux tirs. Tous sont là, en grande conversation. Je suis en robe de chambre, décoiffée. Je demande à Paul d’attendre un moment et que je reviendrai pour le faire entrer. Je me précipite dans le bureau, déplace les matelas dans la pièce voisine, met de l’ordre au décor, enlève les photos de mes enfants, ordonne à tous un silence complet, m’habille hâtivement et me coiffe. Tout cela dure deux à trois minutes. Je sors retrouver Paul. Il est debout, au même endroit, comme pétrifié. Je le fais entrer.
Aussitôt assis, il parle. Me parle. Me regarde comme si j’étais la seule chose au monde qui comptait. Comme si rien n’avait changé. Ni l’adresse, ni l’espace, ni les murs, ni le temps, ni le cadre tout entier. La réalité extérieure n’existait pas. Rien n’existait à part moi. Moi comme objet d’investissement du tout maternel, paternel, protecteur… S’il y avait un agir par rapport au cadre spatial, « externe », il n’y en avait pas au regard de la continuité « interne » que je pouvais lui assurer par le handling qui se prolongeait entre mon cabinet inatteignable à 15 km d’ici et mon domicile, seul lieu accessible où je pouvais l’accueillir. Je sentais que j’étais moi-même porteuse du cadre. Bien plus, je sentais que j’étais le cadre. La matrice protectrice c’était moi, mais aussi ce que je faisais de ce lien entre lui et moi. Ce que je faisais de la rencontre : la relation psychanalytique. Ce que je faisais de l’inter-relation de l’échange analytique de cette rencontre entre moi, analyste, et lui, analysant. Sans confondre l’investissement transférentiel et ma personne [5].
Nadine
Je voyais Nadine et Karim depuis un an déjà. Ensemble. Chacun seul. Depuis un mois, ensemble à nouveau. De l’amour le plus fort à la haine la plus extrême, de l’exaltation passionnelle aux sentiments les plus hostiles… tout y était. Comme dans tous les couples.
Lundi 11 heures. J’attends Nadine et Karim. Il est 11 h 15. Ils sont en retard. Il est 11 h 30. Ils n’arrivent pas. Ils ne viendront probablement pas. Ils ne viennent pas. Ils se sont beaucoup disputés la dernière fois. Nadine avait exprimé son désir de le quitter. Je pense : peut-être que c’était aussi son désir de me quitter ? Je m’inquiète un peu. Karim était violent. Lui a-t-il fait du mal ?
Mercredi 10 h 15. Viendront-ils aujourd’hui ? 10 h 20. Ils n’arrivent pas. 10 h 25. On sonne à la porte. J’ouvre. Je vois apparaître Nadine. Seule. Toute habillée de noire. Un voile blanc sur la tête, signe de deuil en Islam. Instantanément un lien se fait dans ma tête. Le spectacle de l’attentat vu à la télévision, les victimes en morceaux, et l’adresse de Nadine et Karim dont ils avaient parlé en séance.
Je regarde Nadine. Elle me regarde intensément. Comprend que j’ai compris. Elle fait quelques pas. Je lui tends la main pour la poignée de main habituelle. Elle se jette en pleurs dans mes bras.
Je pense à la neutralité bienveillante, à la règle d’abstinence, à la loi tiercéisante… mais je pense aussi à sa douleur et à son besoin d’être contenue par ce holding inattendu, pour s’assurer que je suis là et que je peux lui apporter ce sentiment de continuité dont elle a tant besoin après la mort de Karim. Elle s’abandonne un moment dans mes bras. Je la contiens, sans bouger. Je pense à Winnicott. Je me sens structure encadrante. Elle pleure en répétant : « Je ne voulais pas qu’il meurt… Je ne voulais pas qu’il meurt… On l’a ramassé en morceaux. » Elle se détache doucement, me regarde et se dirige vers le fauteuil pour s’asseoir à sa place habituelle. Elle se tait un moment puis me parle de ce qui s’est passé ce jour-là… de sa culpabilité si difficile à soutenir.
L’inter-relation comme pare-excitation à l’intrapsychique débordé
Alain de Mijolla, dans Les mots de Freud, rapporte la réponse de Freud à Blanton quand celui-ci lui a demandé s’il avait pu continuer à travailler quand les nazis envahirent l’Autriche. Freud aurait répondu : « Non… quand le conscient est perturbé il est impossible de prendre intérêt à l’inconscient. » [6]
C’est ce qui m’est arrivé avec Émile, oui mais… En effet, je n’avais plus « d’intérêt à son inconscient ». Je ne l’écoutais plus. J’étais prise par une extériorité qui m’empêchait de l’écouter. J’avais peur pour lui, pour moi, pour les personnes de ma famille qui étaient sur les routes… Quand le traumatisme est dans la réalité de l’analyste et de l’analysant comment transformer ? Que devient le rôle de l’analyste ? Pas d’écoute, pas d’interprétations, pas de transformations, juste une présence, le temps de la séance, quand la guerre soudain, dehors, attaque le cadre. Mais en étant là, en respectant son clivage, la névrose de transfert, l’hallucinatoire en séance, qui s’exprimaient plus fortement que l’extériorité traumatique qui pouvait l’empêcher de continuer sa séance, j’ai pu lui offrir un espace pare-excitant et contenir, dans le cadre, le déploiement de son conflit intrapsychique. Comme si malgré tout j’investissais son fonctionnement psychique, par un contre-transfert-rempart entre lui et le monde extérieur. Oui mais… uniquement le temps de cette séance-là, unique, où la guerre fait irruption dans un cadre existant déjà et un processus en cours. Mais si la guerre est d’emblée là et de plus continue, serait-il possible de fixer un cadre et d’investir la relation analytique ? Il me semble que ce serait faire fi de la personne de l’analyste, le réduire à un personnage omnipotent, clivé dans la toute-puissance. Comme s’il pouvait être dans le contrôle face à un cadre imprédictible, un surhomme sans psychisme qui vit dans le déni de la réalité externe et de sa propre réalité psychique.
Avec Paul, le cadre n’était plus le même. Quand le cadre devient inaccessible de par les effets traumatiques d’une guerre, la névrose de transfert semble le réorganiser en faisant disparaître sa matérialité spatio-temporelle qui est transposée sur la personne de l’analyste ; celui-ci n’est plus le gardien du cadre objectif [7], mais devient le cadre lui-même. Là où l’analyste se trouve. C’est l’articulation de la relation transféro-contre-transférentielle qui va organiser la situation. Que va faire l’analyste de la névrose de transfert ? Que va-t-il faire de ce lien entre lui et l’analysant ? Que fait-il de la rencontre qui, dans le cas présent, devient impossible dans le cadre initial ? Pour Paul, l’imminence de la rencontre était un besoin. En reconnaissant le « désir » de Paul de me voir comme un « besoin » [8] – besoin de se protéger contre un débordement économique qui le menace – en offrant à Paul le handling nécessaire d’une mère dévouée à son enfant [9], en acceptant de ne pas m’arrêter à l’idée de l’espace-temps d’un cadre étriqué puisque celui-ci était inaccessible, j’ai privilégié la rencontre, le lien analytique, la relation analytique. La subjectivation de ce lien indéfectible.
C’est ce que j’ai fait de la rencontre avec Nadine, bien que le cadre spatio-temporel soit resté le même. Elle exprimait, par le non verbal, l’affliction immense d’une femme endeuillée. J’étais la seule à pouvoir mettre en sens ce regard en détresse, qui portait en lui la culpabilité extrême d’un désir de mort magiquement réalisé par les effets instantanés d’une bombe. Elle se jette dans mes bras. Que fait l’analyste quand l’agir transférentiel est une demande de contenance d’un traumatisme de guerre doublé ici d’une culpabilité non « psychisable » ? Que va faire l’analyste de son éprouvé contre-transférentiel face à l’horreur d’un drame irreprésentable ? Sans tomber dans un sentimentalisme qui nous aurait entraînées toutes les deux dans un émotionnel incontrôlable, sans me réfugier derrière une règle d’abstinence pour protéger un cadre confiné dans l’imperméabilité d’une distance physique inappropriée, j’ai accueilli Nadine dans mes bras, j’ai accepté, pour un moment, un holding indispensable pour son équilibre économique en péril. Là aussi, comme avec Émile, comme avec Paul, c’est l’articulation entre le transfert et le contre-transfert qui construit et organise la situation, dans une préoccupation constante de préserver l’analytique.
Avec André Green [10] et Paul Denis, nous pensons qu’il ne s’agit pas exclusivement d’intersubjectivité mais « de l’articulation de deux mouvements psychiques spécifiques et de leur élaboration conjointe : la cure psychanalytique n’est pas une interaction mais l’analyse d’une interaction » [11]. C’est ce que nous appelons inter-relation. L’investissement par l’analyste du fonctionnement psychique de l’analysant, sa compréhension de la névrose de transfert comme investissement transférentiel de ce qu’il représente et non de sa personne, apporte une réponse pare-excitante à un risque de débordement quand la destructivité est partout – ici la guerre – et qu’il y a une menace de désintrication pulsionnelle. En période de guerre, dans les cas précités, l’attaque contre le cadre est un travail du négatif qui reste à la périphérie, sans négativer l’inter-relation qui est préservée, toujours investie, autant du côté de l’analyste que du côté de l’analysant. Cette inter-relation va être un îlot, une issue au désir de vivre, quand l’analyste demeure analyste, en allant au- delà du cadre jusqu’à en arriver à même le représenter. Mais si l’analyste ne demeure pas analyste, qu’il est poussé à des agirs maniaques pour triompher de la pulsion de mort, le négatif ne reste pas à la périphérie, il attaque… il n’y a plus d’analyste, il n’y a plus d’analysant, il n’y a plus de cadre, il n’y a plus de surmoi, il n’y a plus d’interdits, plus rien ne reste à part le pulsionnel désintriqué qui désorganise et anéantit.
C’est ainsi que nous arrivons à expliquer, en partie, les diverses transgressions qui ont eu lieu en période de guerre. En effet, certains analystes ont été confrontés à un pulsionnel dévastateur qui les a conduits au sabotage du cadre analytique. Étant seul repère pour soi dans la déréliction d’une pratique isolée, face au déferlement du négatif qui attaquait de toute part, ils se sont sentis démiurges s’autorisant l’illicite, êtres suprêmes, omnipotents, seuls décideurs de leur agir. De même, la situation de guerre où l’impunité est généralisée, a pu aussi nourrir chez certains analystes un fonctionnement pervers préexistant. En effet, ils ont exploité l’état hors-la-loi qui sévissait alors, s’épanouissant sans limites, sans être aucunement réprimés. Il n’y avait plus de lois, ils étaient la loi. La guerre n’a pas créé la morbidité, elle lui a permis de s’exprimer, constituant un lieu d’expression d’une pathologie antérieure [12].
A la question que pose André Green, dans Le travail du négatif : « Le travail du négatif choisira comme enjeu la relation à l’objet pris entre les feux croisés des pulsions de mort et de destruction d’une part, de vie et d’amour de l’autre… Le travail du négatif se résume alors à une question : comment face à la destruction qui menace toute chose, trouver une issue au désir de vivre et d’aimer ? » [13], nous sommes tentées de répondre, « en temps de guerre, par l’inter-relation analyste/analysant, quand l’analyste demeure analyste ». Le relationnel objectal de l’amour et de la vie, face au pulsionnel de la destructivité et de la mort.
Reste alors le véritable travail de l’analyste : l’élaboration du traumatisme psychique à partir du traumatisme dans la culture. Car les bombes qui éclatent, en véritables métaphores du pulsionnel, provoquent blessures et destructions de manière itérative ! C’est là où le cadre analytique peut prendre toute sa place. Trouver une issue à cette répétition en réactualisant des fragments du traumatisme, véritables résurgences du pulsionnel qui revient en se posant dans l’actuel. La situation analytique est alors investie comme solution, comme une boucle du traumatisme où se joue son élaboration.
Quand la destructivité est partout et qu’on est face à l’imprédictible, il ne s’agit plus de tenir à l’immuabilité du cadre ; il ne s’agit plus de « développer la peau épaisse » pour dominer le contre-transfert [14]; il ne s’agit plus de froideur de sentiments [15]; il ne s’agit plus d’interpréter et de transformer. Il s’agit d’être là. D’être psychanalyste… et de le rester. Le rester et créer. Créer en pensant. En pensant la clinique.
Références bibliographiques
Denis P. (2006), Incontournable contre-transfert, Revue Française de Psychanalyse, tome LXX, 2, 331-350).
Freud S. (1912), Conseils aux médecins dans le traitement psychanalytique, OCF, tome XI, Paris, PUF, 2005.
Sigmund Freud-C.G.Jung : Correspondance, vol I (1906-1909), Trad. franc. par R. Fivaz-Silbermann, Paris, Gallimard, 1975.
Green A. (1993), Le travail du négatif, Paris, édit. de minuit.
Green A. (2002), La pensée clinique, Paris, Odile Jacob.
Green A. (2003), Idées directrices pour une psychanalyse contemporaine, Paris, PUF
Khair Badawi M.-T. (1996), Guerre et survie, in Bulletin de Psychologie, Paris, Sorbonne, tome XLIX, n° 424.
Mijolla A. de (1982), Les mots de Freud, Paris, Hachette.
Neyraut M. (1994), Le transfert, Paris, PUF.
Winnicott D.W. (1947), La haine dans le transfert, De la pédiatrie à la psychanalyse, Paris, Payot, 48-65, 1975.
Notes
(Cliquez sur la flèche à la fin de chaque note, pour retourner au texte à l’endroit où vous avez suspendu votre lecture)
1. Au sens que lui donne André Green in Idées directrices pour une psychanalyse contemporaine, Paris, PUF, 2003.↩
2. Le transfert, M. Neyraut, puf, 1994, p. 241.↩
3. M.-T. Khair Badawi, Guerre et survie, in Bulletin de Psychologie, Sorbonne, tome XLIX, no 424, 1996.↩
4. A. Green, La pensée clinique, Odile Jacob, 2002, p.33.↩
5. Paul Denis, Incontournable contre-transfert, in Revue Française de Psychanalyse, Le contre-transfert, tome LXX, no 2, 2006, p. 349.↩
6. A. de Mijolla, Les mots de Freud, Hachette, 1982, p. 54.↩
7. Selon les termes de André Green et Jean-Luc Donnet.↩
8. D.W.Winnicott, La haine dans le contre-transfert, in De la pédiatrie à la psychanalyse, PBP, p.57.↩
9. D.W. Winnicott, idem.↩
10. Op. cit. La pensée clinique, p. 76, 2002.↩
11. P. Denis, op.cit. p. 349, 2006.↩
12. M.T. Khair Badawi, Op.cit. p. 414, 1996.↩
13. A. Green, Le travail du négatif, p.248.↩
14. S. Freud, lettre à Jung, 7 juin 1909, Sigmund Freud - C.G.Jung : Correspondance, vol I (1906-1909), Trad. franc. par R.Fivaz-Silbermann, Paris, Gallimard, 1975, p.309.↩
15. S. Freud, 1912, Conseils aux médecins dans le traitement psychanalytique, in OC, tome XI, PUF, 2005, p. 149.↩