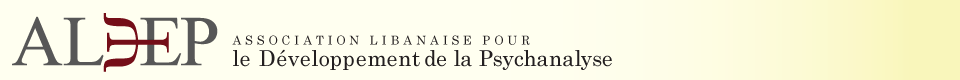Le passage à l'acte comme écriture de l'innommable du traumatisme
(Communication prononcée le 25 mars 2021 dans le cadre des conférences de l'Association Libanaise pour le Développement de la Psychanalyse).
La communication que je veux présenter, ici, se réfère à un travail métapsychologique autour des enfants-soldats, à savoir, ce qui anime dans un premier temps leur pulsion meurtrière devient, dans un second temps, l’événement traumatique qui se répercute sur leur devenir psychique.
Pourquoi ai-je choisi des enfants-soldats et que viennent faire les enfants dans les guerres des adultes ?
D’abord, le recrutement des enfants-soldats n’est pas un phénomène limité aux guerres du tiers-monde ou aux zones décrétées « sauvages » ! Il se produit inéluctablement là où les conditions sont réunies ; d’ailleurs, on a relevé la présence de nombreux enfants-soldats dans les rangs d’un pays européen, le Kosovo.
Actuellement, ce sont des « guerres à l’envers », soldats contre civils, touchent et emportent particulièrement femmes et enfants.
L’effondrement de toute base organisée, de toute structure judiciaire provoque un chaos social et politique qui peut durer des décennies entières. Plus personne ne se donne la peine de respecter les règles internationales de la guerre – Convention de Genève, convention de protection des droits de l’enfant. Dans ces sociétés en morceaux, on oublie tout, jusqu’à la tradition locale de la guerre, ses lois, ses tabous, ses lieux saints.
Restent les enfants et leurs fusils, enfants fétiches de la mère-patrie qui émergent au moment où il n’y a plus d’amitié entre les ennemis. Car les ennemis se reconnaissent en ce qu’ils honorent leurs morts. Ces enfants habillés en soldats apparaissent comme symbole idéal pour combler les défaillances d’une idéologie nationaliste là où les adultes dirigeants refusent de se reconnaître dans leur insuffisance. Dotés du pouvoir des armes, les enfant-soldats vont renverser le jeu et les victimes deviennent bourreaux. Ils prouvent leur « monstruosité » en exécutant parents, amis, voisins et compatriotes.
Drogués, dressés à torturer, à mutiler et à tuer, ils sont souvent, à 12 ou 16 ans, les plus cruels des combattants. Ces gamins ont terrifié tout le monde à l’approche d’un barrage au Liban, en ex-Zaïre, en Iran, au Kosovo, en Iraq et en Syrie.
Qu’en est-il de la puberté chez l’enfant-soldat ?
Ces jeunes étaient, ils sont tous les mêmes : visages de bébé et regards de tueurs, habitués au front, tendus, doigt pressé sur la détente, souvent drogués aux amphétamines, à l’alcool, à la cocaïne, à tout à la fois. Ils ne jouent pas à la guerre, ils sont la guerre. A 14 ans, ce sont des vétérans ; le corps couturé de cicatrices et l’âme en morceaux. Brisés non seulement par la guerre qui les a mis devant l’évidence de la mort, mais par la puberté qui est le temps du trauma sexuel par excellence.
Car, qu’ils soient meurtriers ou sages et menant une vie « normale », les enfants n’échappent pas à cette étape de maturité physique : la croissance, qui porte le sceau de la puberté.
Cette transformation d’un état ancien en un état nouveau donne à l’enfant accès à des fonctions physiques qui supposent une appropriation psychique de son corps transformé.
Toutefois, pour se reconnaître dans cette nouvelle peau, se construire une nouvelle identité dans un projet de vie, devenir autonome, c’est-à-dire établir sur d’autres bases ses rapports aux autres, en particulier à ses parents, il faut nécessairement traverser une période de crise.
Ce processus long et incertain n’aboutit pas toujours. L’histoire de Karim, ex-enfant-soldat, que j’ai choisi de vous présenter, montre les effets destructeurs de son échec.
Il faut cependant préciser que, si j’ai tenu à souligner certains points de cet échec, c’est justement pour pouvoir comprendre comment les enfants-soldats peuvent être confrontés à deux traumatismes : l’un interne (la puberté), l’autre externe (la guerre), et quel est l’impact de ces deux traumatismes sur leur évolution psychique.
La fixation à l’événement traumatique
Ma réflexion porte donc sur l’événement traumatique qui a fracturé leur vie et sur lequel ils sont restés fixés. La fixation à l’événement traumatique m’a interpellée, d’où ma question sur le sens de cette répétition verbale, de ce ressassement de leur histoire.
Les accès de souvenir de Karim reproduit quelque vingt ans plus tard l’événement traumatique tel qu’il l’a vécu dans ses moindres détails. Ceci révèle une catégorie tout à fait particulière de souvenirs : des souvenirs qui ne s’effacent pas et résistent à toute tentative volontaire de les mettre à distance. L’événement traumatique, dans ce cas, reste stocké, encapsulé en matériel brut. Il n’est pas refoulé mais s’impose au sujet en tant que donnée empirique et résiste à toute élaboration. De ce fait, il ne se restitue pas comme trace parce que le refoulement en tant que mécanisme de défense est mis en échec.
Ce souvenir obsédant envahit toute la vie psychique de Karim. Son discours et ses préoccupations rabâcheront sans cesse l’événement traumatique qui a fait un trou non symbolisé dans son histoire personnelle. C’est comme si « l’événement traumatique se trouvait en animation suspendue (…). Cette topique de la terreur ordonnerait la spirale continue du renouvellement permanent du traumatisme » (R. Gori, 1993).
Le cas de Karim
Ce qui marque l’histoire de cet enfant-soldat, c’est précisément le meurtre de son propre père en tant que réalité s’inscrivant dans le fantasme collectif – meurtre du père qui gère le déroulement de la guerre civile. Karim n’a alors qu’une idée en tête : sortir de ce meurtre à travers la vengeance. Ce champ ouvert à la mise en acte de ses fantasmes se propose à lui pour régler ses comptes.
Autrement dit, cette vengeance se présente comme une issue à son ambivalence à l’égard du père, en permettant la mise en actes du versant positif de ce qui était refoulé.
Aujourd’hui âgé de 29 ans, Karim est marié et a un fils. Il travaille comme chauffeur chez un médecin. Il m’avait été adressé par un psychiatre. Musclé, bagarreur, dans le genre caïd, plutôt gauche, on ressentait tout de suite chez lui un malaise à s’exprimer. Il m’a interpellée avec un sourire mi-moqueur, mi-gêné : « Vous allez m’aider à parler… Vous pouvez me poser n’importe quelle question… Je n’ai peur de personne, et je ne regrette rien (silence)… Est-ce que je peux fumer ? » Sans attendre ma réponse, il allume une cigarette.
L’évitement était manifeste dans la position de son corps. Assis face à moi, il se tenait de profil, le regard fixé ailleurs. Il donnait l’impression d’être absorbé par ses pensées. Cependant, la situation s’est vite dégelée et Karim s’est mis à me raconter son histoire. Je suis devenue alors, pour un moment, témoin de la souffrance d’une enfance brisée, malmenée, et d’un parcours poignant dans la terreur.
Karim est le dernier d’une fratrie de quatre enfants, trois garçons et une fille. Son père était gardien dans une agence de voitures. Très humble, il supportait diverses agressions et menaces afin de conserver son travail.
Cependant, cet homme ne put longtemps échapper aux agresseurs. Il fut tué alors que son fils avait 8 ans. Celui-ci se souvient que le jour où l’on a ramené le corps, il a ouvert le cercueil et frappé avec ses mains, en hurlant, le cadavre ensanglanté. Il dit que la représentation de ses mains tachées du sang de son père mort reste toujours présente dans sa mémoire.
Cette phrase peut être comprise de deux manières différentes : « je ne peux oublier ce que mes mains ont fait, la tache de sang en est la preuve. Donc je suis coupable » ; ou encore, littéralement : « Je n’oublierai jamais l’image de mes mains ensanglantées du sang de mon père ».
Cet effet de sidération et de fixation est le signe de l’arrêt du temps logique. Karim s’interroge : « Qui a fait couler le sang de mon père ? » La question demeure sans réponse, il ignore qui est l’auteur du meurtre.
Après la mort de son père, Karim n’a pas pu se soumettre à l’autorité de son oncle paternel ni accepter celle de ses frères aînés, qui étaient déjà engagés dans les milices. D’ailleurs, il était toujours en conflit avec eux : « Je n’ai pas pu supporter leur autorité sur moi », dit-il.
Son refus de l’autorité incite à se questionner sur sa relation avec son père. Il semble bien que ce père ait été un obstacle gênant, malgré le portrait d’un homme effacé et défaillant qu’il en fait. Pour Freud, « les êtres humains ont un grand besoin d’autorité » (S. Freud, 1914) « Qui vient de la nostalgie du père » (S. Freud, 1939). Mais ses inhibitions internes à ses propres impulsions ont fait barrière à toute autorité.
Karim ne pouvait supporter aucun obstacle. On peut se demander si son surmoi s’est constitué dans la mesure où, selon Freud, le surmoi « est d’abord joué par une instance extérieure, par l’autorité parentale» (S. Freud, 1933).
Vœu parricide et culpabilité
A dix ans, il quitte l’école et commence à fuguer. A 12 ans, il s’engage dans les milices et il tue pour la première fois à 15 ans.
Il dit : « Je ne sais pas pourquoi il fallait que je tue un prêtre le jour où un franc-tireur a tué mon ami, le vendeur de journaux, il fallait que je me venge, il fallait trouver un prêtre et le tuer ».
Le mot « prêtre » se dit de deux manières en langue arabe : khoury ou khahen. Toutefois, ces deux mots ne se prêtent pas à une équivocité. Mais Karim, lui, a choisi le mot abouna, qui veut dire littéralement « notre père », pour exprimer son désir de tuer.
D’ailleurs, il faut ajouter qu’il y a ici un double vœu parricide : au niveau individuel d’abord, comme nous l’avons vu chez Karim, et qui se trouve à l’œuvre dans sa violence programmée ; au niveau collectif ensuite, car une guerre civile ne peut se déclencher que par le meurtre du père, garant de l’ordre et de la loi.
Ainsi, le vœu parricide à l’égard du père est ici évident : cette injonction à tuer un prêtre, abouna, confirme que l’acte de Karim s’articule à la question du parricide. Au lieu de l’inhiber par la pensée, il l’exécute.
Karim continue à parler comme dans une rêverie, à « l’heure du loup », où la suite de son histoire commence à déraper, parasitée par des pensées « absurdes ».
Puis il évoque l’histoire de l’agent X qui avait tiré sur lui. Il ne voulait raconter cette histoire à personne, affirme-t-il, mais il ne sait pas pourquoi il la raconte !
Il dit qu’il a recherché cet homme pendant un an. Lorsqu’il l’a retrouvé, il s’est saisi d’une barre de fer et l’a battu… L’homme le suppliait de le tuer… Mais il continuait de frapper en lui posant toujours la même question : « Avec quelle main m’as-tu tiré dessus ? » L’homme finit par avouer, Karim prit alors la main « coupable » et la plongea dans l’huile bouillante qu’il avait préparée à cet effet. Il ne se souvient que des hurlements. Il a oublié ce qu’il a pu ressentir ou penser : « J’étais comme dans un état second… J’étais absent, je ne sais plus ce que j’ai fait. »
Karim disparaît en tant que sujet dans son acte. Il se fait exclure par ce qui l’a exclu de lui-même, par ce qui l’a mis hors de lui, à savoir : la main coupable. Sa rencontre avec le mot « main », avec lequel il entretient un rapport intime d’inquiétante étrangeté, a déclenché son passage à l’acte.
Il continue à parler en associant librement : « Je ne regrette rien, dit-il. J’ai acheté à mon fils une tenue militaire et un pistolet… Je sais que je mourrai tué, je veux être vengé par mon fils. J’aime beaucoup mon fils, mais je ne sais pas pourquoi quand je le frappe… je ne sais pas ce que je fais. L’autre jour, j’ai failli l’étrangler ».
Dans cette opération action-réaction où il se constitue dans son fantasme, Karim perpétue le meurtre parricide-filicide d’une génération à l’autre.
Les phrases à double sens se succèdent, suscitant ambiguïté et doute. A travers elles, Karim résume toute sa tragédie existentielle. Il voudrait à la fois se faire tuer à l’instar de son père, pour payer sa dette à son égard, et se faire venger par son fils comme lui-même l’a fait. Mais en même temps, il essaie d’étrangler son fils, comme pour boucler l’histoire. C’est une inscription de son être dans le registre de l’existence comme témoignage, au-delà de la vie, d’un sens qui est resté ignoré de lui, comme écriture de l’innommable du traumatisme.
Vœu parricide et culpabilité se juxtaposent et se superposent. Ce besoin de punition (« je sais que je mourrai tué ») tire son origine, comme l’a dit Freud, du complexe d’Œdipe, réaction aux desseins criminels de tuer son père et d’avoir des rapports sexuels avec sa mère (S. Freud, 19O6-1927, p. 170). Et cette haine à l’égard du père s’est étendue pour englober tous les membres masculins de la famille, oncles, frères, et fils.
Dans l’acte de torture contre cet autre ennemi et contre son fils, il y a eu « retournement d’une pulsion de l’activité à la passivité et renversement du contenu » (S. Freud, 1894-1924, p. 298).
Lorsque Karim a plongé la main de cet autre, étranger, dans l’huile bouillante, il était dans un état second. Il jouissait de la fureur dirigée sur sa propre personne. L’essentiel dans ce processus est le changement d’objet, le but demeurant, lui, inchangé. Ce combattant a besoin d’un « objet », une personne étrangère, pour assumer son rôle de sujet (plongeant sa main dans le sang de son père mort).
Dans ce cas aussi, la satisfaction passe par la voie du sadisme originaire : le moi passif reprend en effet, sur le mode fantasmatique, sa place antérieure qui est maintenant cédée au sujet étranger.
« Ce besoin autopunitif constitue la nécessité de réaliser un acte – dont le paradigme est le parricide originaire –, un acte qui permette à la mémoire de s’emparer dans et par l’actualité d’un événement crée, des traces de souvenirs absents, forclos (…) Comme si le trauma n’avait pu ici trouver de points de connexion avec la pensée et la parole » (R. Gori, 1991, P.17-18). L’événement traumatique qui a fait basculer sa vie est « resté enkysté » dans le psychisme jusqu’à chercher et trouver désespérément une solution, un motif dans le passage à l’acte.
Mais à quoi correspond cette tache sanglante que Karim tient tant à effacer ?
En fait, elle est à la fois signe de vengeance et de culpabilité. Elle correspond à un vœu parricide, à un souhait inconscient de tuer son père. C’est le triomphe de son vœu œdipien. Pour venger son ami, il n’a trouvé qu’un prêtre à tuer. Quant à la séance de torture, elle est aussi un moyen d’effacer la tache, la trace du sang de sa propre main, la main meurtrière, et d’effacer du même coup la trace psychique qui demeure ancrée dans la mémoire, pour pouvoir vivre avec cette culpabilité inconsciente.
La culpabilité comme les vœux parricides sont sous-jacents dans tous les agis de ce combattant. Il s’agit ici d’une culpabilité inconsciente. C’est plutôt un « besoin de punition » (S. Freud, 1894-1924, P. 298). Elle n’émane pas du surmoi, car le sentiment de culpabilité manifesté par ce dernier est essentiellement critique, selon Freud ; « Le sentiment de culpabilité est la perception dans le moi correspondant à cette critique et (…) déploie contre le moi une dureté et une sévérité (…) extraordinaires » (S. Freud, 1922, p. 26). Les fantasmes de karim possèdent une réalité psychique opposée à la réalité concrète, la réalité extérieure.
Les événements extérieurs, à savoir la guerre civile, ont constitué le support de la mise en œuvre de ses fantasmes et de ses souhaits incestueux. L’idée de réalité psychique est liée à l’hypothèse freudienne touchant les processus inconscients ; non seulement ceux-ci ne tiennent pas compte de la réalité extérieure, mais ils la remplacent par une réalité psychique… La réalité psychique désignerait le désir inconscient et le fantasme qui lui est lié.
Dans ces passages à l’acte de terreur, Karim écrit une parole qui n’a pas pu se dire, qui n’a pas eu lieu. Ainsi, l’acte vient à la place des mots qui permettraient d’exprimer sa haine œdipienne. L’histoire de Karim en est un exemple ; cette injonction de tuer ‘abouna’ confirme que son acte s’articule à la question du parricide ; au lieu de l’inhiber par la pensée, il l’exécute. IL n’y a plus intelligence de la pensée pour inhiber l’acte, mais intelligence de l’acte qui s’accomplit. De ce fait, le passage à l’acte est à considérer comme le meurtre du langage.
La crise de la représentation est à l’œuvre.
Dans la répétition de ces passages à l’acte, c’est une dynamique de dé symbolisation qui s’entame. Le trauma n’est pas refoulé, mais s’impose au sujet en tant que donnée empirique et résiste à toute élaboration. Le sujet se trouve interdit devant une chose pour laquelle il n’a rien à dire. Car le réel ici apparu, touche à la pulsion. Il ne peut se résorber dans le symbolique et, de ce fait, échappe à la symbolisation. Le sujet s’efface, son acte devient sa signature, une signature archaïque à la place de son nom.
Références bibliographiques
Freud S. [1918], Remarques sur un cas de névrose obsessionnelle, in Cinq psychanalyses, Paris, Puf, 1975, 28.
Freud S. [1939], L'homme Moïse et la religion monothéiste, Paris, Gallimard, 1983, 207-208.
Freud S. [1933], Nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse, 87.
Freud S. [1919], L’inquiétante étrangeté, L’inquiétante étrangeté et autres essais, trad. fr. A. Bourguignon, Paris, Gallimard, 1985 ; GW, XII.
Freud S. [1924], Le problème économique du masochisme, in Névrose, psychose, et perversion, Paris, Puf, 298.
Freud S. [1923], Le moi et le ça, in Essais de psychanalyse, Paris, Payot, 268.
Gori R., Acting out-de parole, Cliniques méditerranéennes, 1991, 29/30, p. 17-18.
Gori R., L'horreur en vue, Cliniques méditerranéennes, 1993, 29/40, 53-55.
_______________________
Illustration : Ara Azad, Silent Dignity, mixed on canvas 51cm x 41cm USA 2014, Beirut 2017.