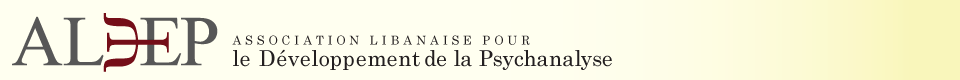Le contre-transfert/sauveur
Quand des traces traumatiques douloureuses nourrissent le contre-transfert et se révèlent au psychanalyste… quatorze ans après !
Ce texte a fait l’objet d’une conférence dans un Panel au cours du Congrès de l’International Psychoanalytical Association à Prague en juillet 2013. Il a été publié en anglais dans l’International Journal of Psychoanalysis, Volume 96, number 6, December 2015, edition Wiley/Blackwell sous le titre: The saviour/countertransference: When painful traumatic traces sustain the countertransference and reveal themselves to the psychoanalyst … 14 years later. En outre, il a aussi fait l’objet d’une conférence-débat dans le cadre des conférences de l’Association Libanaise pour le Développement de la Psychanalyse - ALDeP, le 6 mars 2014.
Parce que c’était lui [elle] parce que c’était moi.
(Montaigne, en parlant de La Boétie)
Ce qui compte ce n’est pas tant ce que l’analyste dit ou fait, mais ce qu’il est.
(Sacha Nacht [1962, p. 207]).
« Vous, les psychanalystes, vous devenez tous fous ! », « Il n’y a pas un seul psychanalyste équilibré… » La représentation collective du personnage du psychanalyste est largement corroborée par l’histoire de la psychanalyse qui a vu cheminer vers la folie plusieurs de ses grands hommes : Jung, Reich… pour ne citer que deux exemples éloignés, afin d’éviter la polémique autour d’exemples plus proches. Dans le même ordre d’idées un collègue universitaire, non psychanalyste, me répète sans cesse : « À deux les psychanalystes parlent, à trois ils se disputent, à quatre c’est la scission et la multiplicité des écoles psychanalytiques ! »
Pourquoi donc ces clichés largement répandus ? Qu’est-ce qui fait cette réputation aux psychanalystes ?
Un psychanalyste doit avoir examiné – et résolu ! – ses motivations inconscientes pour un métier qui requiert une sensibilité à l’écoute de la fragilité de l’autre, sensibilité qui pourrait n’être en réalité que le reflet d’une fragilité bien enfouie en lui. Mais dans les commentaires tels que rapportés, le psychanalyste nous apparaît comme étant pris dans une situation où quelque chose de son monde pulsionnel n’est pas/plus contrôlé. En effet, il est confronté en permanence au pulsionnel de l’autre, au retour du refoulé de ses analysants… mais aussi à son propre monde pulsionnel et à son propre retour du refoulé. Si son refoulé a été tourné, retourné, re-retourné dans tous les sens au cours de son analyse avant d’être refoulé à nouveau, il n’en reste pas moins qu’il revient incessamment face au pulsionnel pur de la régression du patient aux positions les plus archaïques, bien que nous ne puissions créer une symétrie qui annule la différence entre les deux protagonistes ; le psychanalyste est supposé avoir été analysé et censé fixer lui-même les règles de la cure (Green, 2002, p. 343).
Ce phénomène clinique, Freud le nommera pour la première fois contre-transfert – le 7 juin 1910 – dans sa fameuse réponse au télégramme de Jung qui lui confie avoir eu des relations sexuelles avec Sabina Spielrein (Freud-Jung, 1975, p.309). Considéré par lui comme un obstacle dans la cure, voire même par Ferenczi comme une « source d’erreurs » que le psychanalyste doit savoir empêcher et neutraliser, il faudra attendre les développements des auteurs britanniques dans les années quarante pour assister à une évolution de ce concept. Développer l’apport de ces auteurs au remaniement de la notion de contre-transfert dépasse le cadre de cet article et nécessiterait un essai à part. Toutefois, nous allons essayer de suivre le fil rouge qui a conduit dans les années quarante, à sa transformation de la conception d’obstacle à celle d’outil qui fait avancer la cure.
Après qu’un élève de Ferenczi, Michael Balint, publie en 1939 avec sa femme Alice un article sur Le transfert et le contre-transfert qui introduit l’idée d’un contre-transfert « normal » de l’analyste qui entre en interaction avec le transfert du patient, il faudra attendre la conférence de Winnicott en 1947 « La haine dans le contre-transfert » pour trouver la contribution majeure sur le sujet. Il y développe l’idée que si le psychanalyste ne prend pas conscience d’une forme de haine qu’il nomme « objective » envers son patient psychotique autant qu’envers son patient névrosé, aucune analyse n’est possible. Il doit être attentif à l’apparition de la haine en lui afin « d’espérer éviter que la thérapie soit adaptée aux besoins du thérapeute plutôt qu’aux besoins du malade » (Winnicott, 1976, p 58). Avec Winnicott c’est certes la reconnaissance du contre-transfert comme un éprouvé, mais on n’en n’est pas encore à l’envisager comme un instrument de travail ainsi que va l’introduire un auteur non-britannique, un psychanalyste argentin, H. Racker, en 1949. Ce dernier va décrire une véritable « névrose de contre-transfert » en complémentarité avec la « névrose de transfert » qu’il définit comme « tout ce qui vient à l’analyste comme réponse psychologique face à l’analysant » (Racker, 1997, p. 174). Le psychanalyste doit en prendre conscience, soumettre cette « névrose de contre-transfert » à son auto-analyse, afin d’y reconnaître les différentes formes d’identifications au patient. Pour Racker, c’est à travers les effets de cette identification sur sa propre vie psychique que le psychanalyste arriverait à une meilleure connaissance de la réalité psychique de son analysant.
La même année, en Angleterre, P. Heimann aboutit elle aussi à penser le contre-transfert comme un instrument du travail de l’analyste pour la connaissance de l’inconscient du patient, utilisant pour la première fois le terme « d’outil de travail » pour qualifier sa fonction capitale dans l’évolution du processus analytique (Heimann, 1949). Deux ans plus tard, dans la même mouvance, en 1951, une analysante de Winnicott, M. Little, va à son tour confirmer cette nouvelle manière de concevoir le contre-transfert. Son apport original reste sa mise en garde aux psychanalystes contre leur lutte qui peut devenir même une phobie, face à ce qu’ils éprouvent vis-à-vis de leurs patients. Ce contre-transfert existe, ne peut être évité, est particulier à chaque processus analytique dans la relation entre un psychanalyste et son analysant et doit même être partagé et utilisé comme moyen pour faire progresser la cure (Little, 1951).
Arrêtons là ce rapide survol. L’essentiel étant d’avoir mis en évidence le grand tournant des années quarante grâce aux auteurs britanniques, qui ont reconnu le contre-transfert comme faisant partie intégrante du processus analytique et l’ont transformé en véritable « outil de travail » pour le psychanalyste. Ce qui apparaît de nos jours comme une évidence pour un grand nombre de psychanalystes, représentait à cette période une véritable révolution.
Depuis le développement de ces nouvelles conceptions du contre-transfert, nous retrouvons diverses propositions qui tentent d’expliquer ce phénomène clinique. « Devant la même expérience clinique, on peut utiliser des modèles théoriques différents » nous dit bien Widlöcher (1996, p. 166). Du contre-transfert à l’identification projective, du pictogramme à l’interaction, de l’intersubjectivité à la co-pensée, de la rêverie à la figurabilité…, que de concepts qui tiennent compte de l’analyse de l’interaction entre deux psychismes à l’intérieur d’un cadre bien délimité qui permet le déploiement du processus de la cure. Comme si cette multiplicité de théories venait combler ce que Freud n’avait pas suffisamment élaboré. En effet, comme nous l’avons mentionné, tout en reconnaissant le contre-transfert, Freud ne cessera d’en parler comme un obstacle et « ne passera jamais d’une perspective sujet-objet à la perspective intersubjective » (Widlöcher, 1996, p.159). Notons au passage que Lacan a largement attaqué et critiqué la progression du concept de contre-transfert dans la psychanalyse britannique tel que nous l’avons développé, en arrivant jusqu’à le classer parmi les concepts suspects et à le considérer comme une « impropriété conceptuelle » ! (Lacan, 1961).
Toutes ces théories se recoupent pour expliquer un même phénomène clinique : le psychanalyste n’est plus ce personnage avec « une froideur de sentiments» (Freud, 1912a, p. 115) qui contrôle toutes ses émotions, enfermé dans son omnipotence. Bien au contraire, ce qu’il ressent est à prendre en compte dans le processus de la cure, dans ce qui inter-réagit de manière singulière avec ce patient-là et non pas avec un autre. C’est de l’articulation transfert/contre-transfert qu’il s’agit. De la prise de conscience par le psychanalyste de ce qui se joue dans cette « communication psychanalytique » particulière (Widlöcher, 1996, p. 172), entre son inconscient et l’inconscient de l’analysant, dans l’hic et nunc de l’espace du cadre fixé par lui. Avec des invariants de base identiques, il n’y a pas un psychanalyste qui est similaire à un autre (Winnicott, 1976, p.49), comme il n’est pas non plus le même avec chacun de ses analysants (Heimann, 1949, Little 1951). C’est ce que nous avons nommé ailleurs inter-relation (Khair Badawi, 2011), car il ne s’agit pas d’intersubjectivité mais de « l’articulation de deux mouvements psychiques spécifiques et de leur élaboration conjointe : la cure psychanalytique n’est pas une interaction mais l’analyse d’une interaction » (Denis, 2006, p.349).
Dana est une analysante qui m’a appris ce qui s’élabore inconsciemment, quand l’articulation transféro-contre-transférentielle « sauve » une situation qui aurait pu ne pas advenir. Quand la réalité psychique prend le dessus sur la réalité factuelle, quand des traces traumatiques douloureuses sont à l’œuvre et nourrissent le contre-transfert, à l’insu du psychanalyste.
Dana
Je l’appellerai Dana. Elle devait avoir quarante ans. Dans le primum movens de la première rencontre, elle m’apparaît belle. Très belle, avec de longs cheveux blonds. Très belle mais… insupportable ! Elle me raconte qu’elle a « essayé » tous les psychanalystes en ville et qu’ils sont tous des nuls. L’un l’aurait chassée, l’autre « voulait [la] sauter », un autre encore lui aurait expliqué qu’elle n’avait pas besoin d’un suivi… Mais voilà, elle s’ennuie. « Une sorte de mal-être », confie-t-elle. Elle a tout : un mari avec une belle situation qu’elle a épousé à vingt ans, quatre enfants superbes qui réussissent très bien mais dont elle ne s’est jamais vraiment occupée, une belle maison, une belle voiture… D’emblée, elle raconte que son mari « ne bande plus » depuis dix ans et qu’elle a des amants « juste pour combler le feu au cul ». Tous les hommes sont à ses pieds, son mari aussi. Elle a tout. Un bon niveau social, de l’argent, un mari, des hommes, des sorties tous les soirs, du sport tous les jours, des déjeuners avec des copines, du shopping à volonté, des voyages… « J’ai tout, tout, tout… mais je m’ennuie » se plaisait-elle à répéter comme une antienne tout au long de l’entretien.
J’étais perplexe. J’étais envahie par une logorrhée qui semblait ne jamais s’interrompre. Elle causait… causait… avec une crudité dans le discours, sans relâche, sans latence, sans émotion, aucune. Aucune demande, aucune douleur, aucune souffrance, aucune culpabilité. Juste des mots, des phrases, côte à côte. Sans affect. Sans résonnance fantasmatique. Elle ne m’accordait aucune occasion pour placer un mot. Au bout de quarante minutes je m’interrogeais sur ce que j’allais en faire. Pourquoi était-elle là ? J’éprouvais une sorte de répulsion face à ce discours de femme désœuvrée, vide, sans intérêts. « Une sourde muette de l’affect » pensai-je en évoquant P. Marty. Un fonctionnement limite comme on en voit tellement de nos jours. J’étais dans le jugement. Sans possibilité de neutralité bienveillante. Sans « accueil » [Neyraut (1994), de Urtubay (2006), Denis (2006)], ce contre-transfert qui est « déjà là » dans le désir d’aider, que Lacan n’appellerait pas contre-transfert mais « désir du psychanalyste », point-pivot de ce que le « psychanalyste supposé savoir » est censé connaître de là où il veut conduire son patient dans la cure (Lacan, 1964, p.257). D’ailleurs Freud avait bien dit que si le psychanalyste n’éprouvait pas dans le premier entretien ce désir d’aide, il valait mieux ne pas continuer. Je me sentais plus que jamais en accord avec lui. Je la trouvais INSUPPORTABLE. Je devais l’orienter. Je me préoccupais des prétextes à créer pour l’éconduire de manière professionnelle, comme d’autres l’avaient déjà fait avant moi. Du reste, elle avait évoqué le nom de X, un excellent psychanalyste. Je ne pouvais pas réussir là où lui avait échoué !
Mais voilà qu’à la fin de l’entretien je m’entends lui dire : « Nous pourrions prendre un autre rendez-vous si vous voulez ». Elle acquiesce. Je lui donne un deuxième rendez-vous.
Elle partit, laissant derrière elle un parfum agréable mais tenace. « Son halo de séduction. Rien que de l’excitation. De l’hypomanie. Une lutte antidépressive », pensai-je. Avec un tel dysfonctionnement, avec une telle pauvreté de la vie psychique en capacité de mentalisation, ce n’est pas à un psychanalyste qu’elle devrait avoir recours. Elle s’est trompée d’adresse. Il fallait l’orienter vers une autre technique. Mais pourquoi donc la revoir alors que je pensais tout cela et que j’avais un mouvement de répulsion à son égard ? Pourquoi lui avoir donné un deuxième rendez-vous ? J’étais tourmentée face à un vague sentiment d’insatisfaction. J’essayais de comprendre… Je me demandais s’il ne s’agissait pas de rivalité avec ce collègue X qu’elle avait cité comme l’ayant chassée : oui, j’allais réussir là où lui avait échoué, là où tous les psychanalystes et thérapeutes avaient lamentablement échoué avant moi. Était-ce cela ? Et puis elle était tellement belle ! Était-ce un contre-transfert homosexuel ?
Elle revint une deuxième fois, une troisième et une quatrième fois. Puis, je lui fixais un cadre. Débutante à l’époque, j’évoluais avec beaucoup de prudence. Suivant à la lettre les indications de ma formation - à ce moment-là on était très réservé pour mettre sur le divan ce genre de fonctionnement - il ne s’agissait certainement pas pour moi de l’allonger. Je lui proposais deux séances par semaine, qui devinrent bientôt trois, en face à face évidemment. Ayant plus d’assurance certes aujourd’hui, j’aurais peut-être osé me lancer et la mettre en position couchée. Mais même maintenant, je prends toujours garde à ces organisations psychiques où l’agir est au premier plan, avec en moi l’appréhension d’ « acting-in » ou d’ « acting-out » dangereux et imprédictibles. Mais pourquoi donc s’acharner à allonger ces personnes impudentes alors que nous pouvons leur offrir de véritables analyses en face à face ? Ne s’agit-il pas d’une forme de contre-transfert qui pousse à mettre sur le divan ces patients « insupportables » pour nous débarrasser de l’accrochage visuel plus difficile avec eux qu’avec les autres analysants ? N’était-ce pas là le but avoué de Freud au moment du passage historique à la position allongée, moment où il n’avait pas encore suffisamment identifié ses émois contre-transférentiels qu’il ne reconnaîtra que plus tard, mais comme obstacle, sans jamais leur accorder une valeur d’outil tel que nous le soulignons plus haut ?
Comme on pourrait s’y attendre, Dana eut beaucoup de mal à accepter le cadre : « Je veux parler comme à une bonne copine… vous savez tout de moi mais je ne sais rien de vous, c’est à votre tour de me raconter votre vie… pourquoi je dois payer les séances ratées, vous devriez vous aussi me payer les séances quand vous partez en voyage… » Il n’y avait pas de différences entre elle et moi et si elle venait me voir c’était juste pour converser. Elle ne pouvait quand même pas parler sans méfiance avec des copines qui la jalousaient et ne pensaient qu’à la copier !
Le cadre instaurait une asymétrie. Elle ne la supportait pas.
Très vite, je repérais des failles narcissiques graves et une carence maternelle précoce, que j’entendais dans mon écoute interprétative, mais que je me gardais bien de lui interpréter au départ. J’interprétais très peu d’ailleurs, lui livrant des interprétations plutôt explicatives comme nous le faisons d’habitude avec ce type de fonctionnement limite, les interprétations pouvant être ressenties comme attaquantes, ce qu’elle me renvoyait généralement en mobilisant des défenses gigantesques. Un jour où je me risquais à lui interpréter le sentiment d’abandon qu’elle a pu ressentir face aux multiples voyages de sa mère qui partait pour de longs mois la laissant seule depuis son plus jeune âge avec une femme de ménage et un père pris par son travail, elle riposta vivement : « Où donc allez-vous puiser ces idées bizarres ? Vous êtes vraiment drôle. Je ne vous ai jamais dit cela. Ma mère a toujours été une très bonne maman ». Un bouillonnement interne me gagnait. Comment continuer à travailler avec ce mouvement contre-transférentiel négatif mobilisé constamment face à toutes ces attaques répétées et sans cesse renouvelées ? Elle continuait à venir. Je continuais à l’attendre. Malgré tout. D’où venait cette persévérance ?
Un transfert envahissant s’installa, témoin d’une régression infantile massive et d’une immense demande d’amour. Après chaque séance, elle avait du mal à partir, à me quitter : « Laissez-moi encore un peu avec vous » me disait-elle à chaque fin de séance. Assurément, je ne cédais pas à sa demande et l’accompagnais à la porte. Avec une forme de bienveillance que j’arrivais à lui montrer. Était-ce sa problématique d’enfant délaissée qui m’avait un peu attendrie et aidée à métaboliser mon rejet pour échapper à la répétition de l’abandon ? Peu à peu, j’arrivais à être ce réceptacle pare-excitant qui aide et qui structure, dans un mouvement contre-transférentiel ambivalent certes, mais contenant quand-même désormais.
Un jour, elle demeura une matinée entière dans l’entrée de l’immeuble, mon cabinet étant au rez-de-chaussée, afin de me voir apparaître dans l’encadrement de la porte entre deux patients. C’était certes le vide de son monde interne qui la rendait incapable de « m’internaliser », mais c’était aussi sa manière d’exprimer son transfert maternel et son désir d’être enfin aimée par une mère qu’elle a toujours vécue comme rejetante et défaillante. Elle voulait être mon enfant unique, entrant en rivalité avec mes autres analysants.
Face à la frustration qu’elle ressentait, elle protestait en m’attaquant. De fortes pulsions destructrices qu’elle projetait en moi surgissaient. Elle allait, me menaçait-elle, sonner sans s’arrêter à ma porte pour m’empêcher d’être avec les autres patients. Le transfert devenait de plus en plus envahissant et… encombrant. J’ai même remarqué qu’elle me suivait : deux fois en voiture et plusieurs fois je la vis m’observer alors que je faisais des courses dans le quartier. Dans la même mouvance, elle me téléphonait sans cesse. Je lui rappelais le cadre : « Nous en parlerons à votre séance quand vous viendrez », lui répliquai-je à chaque fois.
Le cadre imposait une frustration. Elle ne la supportait pas.
Dans un mouvement contre-transférentiel « d’exaspération » je m’accrochais au cadre. Le cadre comme limite, comme fonction paternelle. Pour la protéger de ses agirs transférentiels, autant que pour me protéger moi-même. J’étais envahie par son transfert massif et ses passages à l’acte, mais j’étais également envahie par une lutte contre des mouvements contre-transférentiels mortifères, qui, j’en étais consciente, pouvaient me conduire, en miroir, jusqu’à des passages à l’acte à mon tour : je retenais mon envie de la chasser de l’entrée de l’immeuble, je m’empêchais de la gronder quand je repérais qu’elle me suivait, je réprimais des mots agressifs quand elle me téléphonait plusieurs fois de suite…
Je m’observais dans une auto-analyse sans fin, cette auto-analyse dont parle Freud (1937), qui se prolonge après l’analyse du psychanalyste et qui l’accompagne indéfiniment dans son travail. Je sollicitais même un très estimé collègue pour en discuter avec lui. Quelle ne fut pas ma surprise de l’entendre dire : « Mais c’est de Dana qu’il s’agit ! Comment tu fais pour la supporter ? C’est ton masochisme » ricanait-il. Il m’avoua qu’il y a deux ans, il avait eu un unique entretien avec elle. Il avait ressenti un tel contre-transfert négatif face à « ses agirs et son vide abyssal » qu’il n’avait pas pu lui en proposer un autre. Il l’avait orientée ailleurs.
Oui, il avait raison. Je devais comprendre. Comment est-ce que je fais pour la supporter alors que, comme les autres, je l’avais trouvée insupportable dès le début ? Pas plus tard qu’hier elle m’avait interpellée si agressivement que j’ai eu beaucoup de mal à garder ma neutralité (apparente !) : « On m’a dit que les psychanalystes étaient des gens tordus mais je n’aurai jamais imaginé que ça pouvait atteindre un tel niveau de drôlerie. C’est vraiment trop. Vous êtes vraiment nulle… Vous avez trois thèmes de prédilection : soit ma mère, soit mon père, soit la rivalité avec mon frère. Il est temps de trouver un autre sujet de conversation ». Sous la pression d’un contre-transfert négatif, mes collègues psychanalystes l’avait mise à la porte dès le commencement. Et moi, pourquoi ne l’avais-je pas fait ? Je pourrai trouver une excuse professionnelle en lui indiquant qu’une autre forme de thérapie lui serait plus profitable. Pourquoi je ne le lui dis pas ?
Et elle était là. En face de moi. Trop occupée par la provocation et le « faire ». Trop occupée à obtenir une réaction chez l’autre. Mais comment donc l’inciter à prendre conscience du contenu de ce qu’elle disait ? Comment l’aider à construire un espace psychique pour sortir du défi et de l’action ? Un travail sur le pré-névrotique s’imposait pour l’amener graduellement à un questionnement sur ce qui pouvait venir d’elle. J’étais donc arrivée, depuis un bon moment, à neutraliser les mouvements contre-transférentiels de répulsion que j’avais eus, pour aboutir finalement à un véritable désir de l’aider. N’était-ce pas cela qui avait participé à « sauver » le travail psychanalytique avec elle le rendant possible et le faisant avancer ?
C’est ainsi que petit à petit, tout le long d’un processus difficile et agité, l’excitation permanente de Dana céda la place à des capacités psychiques insoupçonnées. Ses agirs répétitifs diminuèrent. Elle investissait le travail analytique et je ressentais que de mon côté, j’investissais son fonctionnement psychique. Elle ne ratait aucune séance. Six ans durant. Trois fois par semaine. Elle a ainsi cheminé lentement et progressivement, vers le développement d’un pouvoir d’internalisation, en investissant son monde interne, en accédant à un sentiment de continuité psychique qui lui procurait, dit-elle, un « mieux-être ». Certes, elle n’est pas arrivée à un fonctionnement névrotique. Mais le travail avec elle qui a duré six ans, a pu névrotiser des éléments que j’avais repéré comme étant névrotisables.
Il y aurait beaucoup à dire sur le processus de cette cure. L’essentiel étant de souligner que nous avions réussi par notre « construction commune » (Widlöcher, 1996, p. 169) à créer une transformation, une réorganisation psychique, au sens métapsychologique du terme. Grâce à l’inter-relation entre elle et moi, grâce à cette spirale transféro-contre-transférentielle à l’intérieur d’un cadre analytique bien défini qui préservait l’asymétrie, alors qu’elle ne voulait aucune règle, aucune loi, aucune différence entre nous. Ses agirs, son agressivité, sa destructivité, attaquaient le cadre et auraient pu l’anéantir par toute cette projection du négatif (au sens que lui donne André Green). Mais en lui offrant une contenance, en lui présentant la possibilité d’une tiercéité à l’intérieur d’un cadre analytique, en demeurant psychanalyste face à ses attaques itératives, j’ai pu rester là, en gardienne du cadre, et préserver ma fonction de psychanalyste autour de ce qui s’est tissé entre elle et moi, dans l’articulation du transfert et du contre-transfert qui a organisé et « sauvé » la situation analytique.
Dès le début. J’ai supporté l’insupportable. J’ai pu être psychanalyste malgré tout. Ce que les autres psychanalystes n’avaient pas réussi à être.
Oui mais… Pourquoi ? Pourquoi moi et pas les autres psychanalystes avant moi ?
Quand les traces traumatiques et la douleur qui leur est liée nourrissent le contre-transfert/sauveur
Ce n’est que dans l’ « Après-coup » que j’ai compris. Longtemps après qu’elle soit partie. Quatorze ans plus tard. Quand j’ai croisé Dana dans la rue. Un insight fabuleux me frappa. Un coup de tonnerre aurait dit Louisa de Urtubey (2006). Une sorte de self disclosure qui se dévoilerait au psychanalyste et qu’il ne communique pas. J’étais ramenée loin, très loin dans le temps. Vingt-cinq ans déjà !
Vingt-cinq ans déjà que j’avais rencontré Isabelle. Elle organisait un colloque et me proposait d’y participer. Rapidement, une grande amitié nous lia. Elle était mariée à Sam, un homme politique très connu, qui était menacé d’assassinat. Comme tous les hommes politiques dans cette partie du monde. Elle le protégeait autant qu’elle le pouvait. Elle parlait souvent de son angoisse de le voir disparaître tragiquement.
Nous avions passé cet été 1990 dans les abris. Terrorisés, impuissants. Trois mois durant. La barbarie des bombardements n’avait jamais atteint une telle démesure. Le « narcissisme des petites différences » alimente assurément la plus féroce de toutes les rivalités entre frères ! Le treize octobre, alors que le déchainement des bombes s’accroissait jusqu’à la déraison, il y eu un arrêt fulgurant : un des acteurs de la guerre avait mis bas les armes. C’était la reddition. Cette date, dit-on, marquerait la fin de la guerre. Cependant, nous avions très vite compris que ce n’était que la fin du va-et-vient des bombardements itératifs qui faisaient irruption dans notre quotidien de manière impromptue pendant quinze ans et demi (Khair Badawi, 1996). Car jusqu’à aujourd’hui, de petites guerres se déclenchent à n’importe quel moment, « comme si la guerre était ordinairement là et que nous vivions dans un traumatisme permanent, indéfiniment en sursis » (Khair Badawi, 2011).
Mais à l’époque, face à l’arrêt soudain des pilonnages virulents, nous éprouvions une forme de soulagement. Une sorte de rémission. Plus de bombes. Plus de morts. Plus de peur dans les abris. Nous goûtions, émerveillés mais toujours inquiets, au calme qui régnait.
Une semaine plus tard. J’ouvre la télévision. Je vois, consternée, des corps ensanglantés, étendus par terre. Un homme, une femme, deux enfants. J’observe, ahurie, le corps de la femme en robe de chambre pleine de sang. J’entends, sidérée, le commentateur annoncer : « Des hommes armés sont rentrés dans l’appartement de Sam et l’ont assassiné avec sa femme et ses deux enfants. Leur troisième enfant, une petite fille, s’est cachée sous le lit et a échappé à l’attentat. » J’imaginais la petite fille. Désorientée, je tendais les bras dans le vide, comme pour l’arracher au drame et l’étreindre. Terrassée par la douleur, je regardais Isabelle. Étendue. Là. Par terre. Pleine de sang. Son mari et ses deux enfants aussi. Elle était belle. Très belle, avec de longs cheveux blonds.
Ce n’est que quand j’ai croisé Dana dans la rue, quatorze ans après la fin de son analyse, que j’ai vu qu’elle ressemblait à Isabelle. Une ressemblance bouleversante. Avec ses longs cheveux blonds. Elle m’interpela chaleureusement en m’annonçant qu’elle quittait définitivement le pays avec son mari, rejoignant ainsi le flot migratoire de nos concitoyens plus nombreux à l’étranger que chez nous. Mais je l’écoutais à peine…
J’étais profondément troublée par le réveil de traces traumatiques douloureuses que je pensais avoir résolues. J’étais ébranlée face à la réminiscence de ce qui restait vivant du traumatisme en moi. Frappée de stupeur, j’ai alors compris ce qui s’est réellement passé avec Dana. Si j’avais pu la supporter dès le départ, c’est peut-être en raison de la rivalité avec le collègue X, d’un contre-transfert homosexuel, de mon masochisme…, peut-être. Mais c’était probablement plus que tout, de ce qu’elle me ramenait de mes contenus inconscients refoulés, de la douleur incommensurable que j’avais vécue, de sa ressemblance étonnante avec Isabelle. Je ne l’avais pas vu. Je ne l’ai compris que dans l’ « après-coup ». Je m’étais attachée à la part consciente de la rencontre avec elle (la rivalité avec ce collègue X, sa beauté…), alors que la part traumatique inconsciente était là, dans ma réalité psychique, et que je ne l’avais pas entendue.
Dès le début. Les effets inconscients sur ma vie psychique, non pas de ce qu’était Dana, mais de ce qui m’était renvoyé de mes propres objets internes traumatiques incorporés, induits par elle, ont favorisé « l’inter-relation » entre elle et moi. L’articulation transféro-contre-transférentielle a « sauvé » une situation qui aurait pu ne pas advenir. Les effets du réveil de ma douleur liée à mes propres traces traumatiques, au lieu de constituer une entrave, ont favorisé l’éclosion d’un « contre-transfert d’accueil », rendant le travail avec elle concevable. Ce qui était mon « point aveugle », au sens de Stekel, a rendu possible le déploiement d’un processus qui n’aurait pas eu lieu, si ce « point aveugle » n’avait pas existé. En témoignent les différentes tentatives que Dana avait effectuées auprès d’autres collègues et qui ont échoué. La portée effractive que son type de fonctionnement pouvait provoquer, avait occasionné chez eux un dégoût, « une haine », des agirs contre-transférentiels, qui ont court-circuité l’éventualité d’une prise en charge thérapeutique, de par les effets de la destructivité du travail du négatif (André Green). J’avais effectivement ressenti de la « haine dans le contre-transfert » (Winnicott, 1947). Mais j’ai pu l’exprimer indirectement : par le rappel du cadre, par l’arrêt fixe à la fin de chaque séance, par la frustration de son désir qui s’exprimait dans le transfert positif… Si j’ai pu supporter toute cette tension, si j’ai accepté d’être placée dans la position où elle me mettait, si j’ai pu reprendre dans la cure ce qui semble être les effets de la pulsion de mort, c’est parce que ce qui aurait pu constituer une résistance dans le contre-transfert, a été « un outil extrêmement précieux… un levier » (Heimann 1949, Little 1951) qui a rendu possible mon investissement de sa vie psychique, grâce aux traces traumatiques et à la douleur qui leur est liée, sans lesquelles la relation analytique n’aurait pas eu lieu. C’est cet aspect du contre-transfert que nous appelons contre-transfert/sauveur. Il fait se déployer un processus qui ne serait pas advenu s’il n’avait pas été là. Les psychanalystes qu’elle avait vus sont restés sous la contrainte d’un contre-transfert négatif alors que pour ma part, avec un contre-transfert apparemment négatif, j’ai pu investir le travail analytique avec elle. Car, à mon insu, bien enfoui derrière, se profilait en filigrane un ressenti subjectif, véritable moteur du processus analytique, neutralisant le contre-transfert négatif : le contre-transfert/sauveur, qui était absent chez les collègues à qui elle s’était adressée avant moi. S’il n’avait pas existé, j’aurais agi comme eux, en l’orientant ailleurs dès le premier entretien. Sans lui, je me serais arrêtée au contre-transfert négatif et aucun travail avec elle n’aurait été possible. Reste alors à penser si c’est seulement dans ce cas unique ou bien ce serait une manifestation beaucoup plus répandue. Nous témoignons ici d’un cas particulier qui nous a ouvert les yeux sur un phénomène qui nous semble fréquent. Il serait ordinairement là, souvent non repéré mais agissant, rendant un travail analytique possible avec un psychanalyste alors qu’avec un autre il aurait été inenvisageable.
Mais au-delà de cette ressemblance de Dana avec Isabelle, ressemblance qui l’a rendue supportable, d’autres facteurs peuvent contribuer à faire en sorte que certains patients soient plus supportables que d’autres ou franchement insupportables : chaque articulation transféro-contre-transférentielle est unique, met en jeu une dynamique particulière entre deux inconscients, comme nous essayons d’en cerner les différents aspects. C’est ainsi que prise par ma sidération traumatique de la ressemblance de Dana avec Isabelle, je ne peux m’empêcher d’imaginer que peut-être d’autres facteurs inconscients, qui m’échappent et dont je n’ai pas encore conscience, peuvent avoir joué un rôle pour rendre Dana supportable et auraient pu conduire à une interprétation équivalente ou même… différente ! Je n’arrête pas d’y penser. Je le saurai un jour… ou peut-être pas ! C’est Freud qui me revient à l’esprit quand il signale la diversité de l’interprétation dans le cas du rêve : « J’ai déjà eu l’occasion d’indiquer qu’il n’est, en fait, jamais possible d’être sûr qu’un rêve a été complètement interprété. Même si la solution semble suffisante et sans lacune, il reste toujours possible que le rêve ait pourtant une autre signification » (Freud 1992, p. 208).
Autant que le psychanalyste puisse être attentif à ses mouvements inconscients, autant qu’il puisse faire une auto-analyse permanente, autant qu’il puisse reconnaître et élaborer son contre-transfert, autant qu’il puisse être « capable de ne refouler ni les représentations ni les rejetons pulsionnels correspondants, ni non plus de supprimer les affects » (de Urtubey, 2006, p. 374), il restera toujours des éléments inanalysables. Au sens que leur donne Freud dans L’analyse avec fin et l’analyse sans fin (1937), qui sont « ces éléments durs de l’inconscient, ceux que nous ne rendrons jamais conscients mais qui sont agissants » (de Urtubey, 2006, p. 381).
Dans le cas présent, les éléments agissants d’un contre-transfert, non accessible à la conscience du psychanalyste dans un premier temps – les traces traumatiques douloureuses – ont constitué des ressources qui ont eu un effet thérapeutique. Dans d’autres cas, ils peuvent instaurer un obstacle au déploiement du processus de la cure et négativer la possibilité d’établir une relation analytique : le contre-transfert / sauveur, du côté des pulsions de vie, face au contre-transfert/obturateur, du côté des pulsions de mort.
Le psychanalyste est analysé certes. Mais nous savons aussi qu’il est en analyse continue. Il est confronté, dans sa vie de tous les jours, dans son travail avec ses analysants, à ce qui resurgit constamment de son monde pulsionnel, de ses contenus inconscients refoulés. Qu’il a examinés ou pas, qu’il a résolus ou pas. La complexité de la vie psychique inconsciente fait que, même s’il est supposé avoir résolu ses conflits inconscients majeurs, même s’il est censé métaboliser dans le contre-transfert ce qui surgit de son éprouvé subjectif face à l’excitation permanente du transfert de ses analysants, rien n’est jamais définitivement acquis.
Renoncer à l’omnipotence. C’est ce que les psychanalystes ont tendance à oublier. Ils devraient admettre que quelque chose leur échappe. Que quelque chose leur échappera toujours… Heureusement !
Références bibliographiques
Denis P. (2006), Incontournable contre-transfert, Revue Française de Psychanalyse, tome LXX, 2, Avril 2006, 331-350.
Freud S. (1899), L’interprétation des rêves, Paris, PUF, 1992.
Freud S – Jung C.G, Correspondance, vol I (1906-1909), tr. Fr. par Fivaz-Silbermann R. , Paris, Gallimard, 1975.
Freud S. (1912 a), Conseils aux médecins dans le traitement psychanalytique, OC, tome XI, Paris, PUF, 2005.
Freud S. (1912), Sur la dynamique du transfert, in La pratique analytique, OC, tome XI, Paris, PUF, 2005.
Freud S. (1937), L’analyse avec fin, l’analyse sans fin, in Résultats, idées, problèmes, II, Paris, PUF, 1985.
Green A. (1993), Le travail du négatif, Paris, Édit. de minuit.
Green A. (2002), La pensée clinique, Paris, Odile Jacob.
Green A. (2003), Idées directrices pour une psychanalyse contemporaine, Paris, PUF.
Heimann P. (1949), À propos du contre-transfert, in Le contre-transfert, Paris, Navarin, 1987.
Little M. (1951), Le contre-transfert et la réponse qu’y apporte le patient, in Le contre-Transfert, Paris, Navarin, 1987.
Khair Badawi M.T. (1996), Guerre et survie, in Bulletin de Psychologie de la Sorbonne, 49 (424) : 9-12, pp 412-418.
Khair Badawi M.T. (2011), Being, Thinking, Creating : when war attacks the settings and the transference counter attacks, in The International Journal of Psychoanalysis, vol. 92, 2, April 2011, pp 401-409 (Version allemande, espagnole, portugaise/Brésil, portugaise/Portugal).
Khair Badawi M.T. (2011), Être, Penser, Créer : quand la guerre attaque le cadre et que le transfert contre-attaque, in Revue Française de Psychanalyse, tome LXXV, 4, octobre 2011, pp 1035-1043.
Lacan J. (1961), La direction de la cure et les principes de son pouvoir, in La psychanalyse, vol. 6, Paris, PUF, p. 149-206.
Lacan J. (1964), Le Séminaire, Livre XI, in Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1973.
Neyraut M. (1994), Le transfert, Paris, PUF.
Racker H. (1949), Études sur la technique psychanalytique, tr. fr. Foucher N. et Lecointe P. Lyon, Césura, 1997.
De Urtubey L. (2006), Des origines du contre-transfert, in Revue Française de Psychanalyse, tome LXX, 2, Avril 2006, 371-384.
Widlöcher D. (1996), Les nouvelles cartes de la Psychanalyse, Paris, Odile Jacob.
Winnicott D.W. (1947), La haine dans le contre-transfert, De la pédiatrie à la psychanalyse, Paris, PBP, 48-65, 1976.
Résumé. Bien qu’elle a eu, autant que plusieurs psychanalystes avant elle, un mouvement contre-transférentiel de répulsion envers une patiente qui présente un grand déficit dans sa capacité de mentalisation, l’auteure essaye de comprendre comment elle a pu la supporter, l’investir et l'amener à un pouvoir d’internalisation, au bout de six années de travail analytique chargé en agirs transférentiels transgressifs. Elle prend alors conscience – quatorze ans après ! – de la manière dont les effets du réveil d’une douleur, liée à des traces traumatiques vécu dans son histoire personnelle ont nourri, à son insu, un contre-transfert /sauveur, créant une spirale transféro-contre-transférentielle spécifique qui a sauvé une situation qui aurait pu ne pas advenir. Grâce à ce qu’elle appelle l’inter-relation singulière entre elle et cette patiente-là.
Mots-clés. Transfert/Contretransfert. Contretransfert/Sauveur. Interrelation. Intersubjectivité. Traumatisme. Guerre. Travail du négatif.