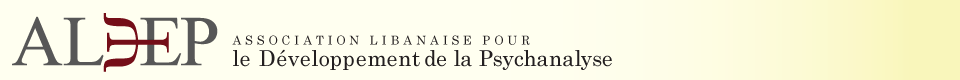Une jouissance déshumanisante
Une filiation par la terreur
(Article publié dans la revue Cliniques méditerranéennes, 2001, Érès, N° 64)

Les enfants-soldats, nouveaux « instruments de mort » de notre siècle, sont actuellement 300 000 dans le monde. Hormis le fait que ces « outils vivants » des conflits armés hors les lois de la guerre étaient et sont utilisés, puis jetés et oubliés par les adultes, leur instrumentalisation en « machines de mort » provoque chez eux un sentiment déshumanisant et une jouissance interdite, puisqu’ils s’engagent dans une lutte contre l’autre qui s’inscrit dans un contexte où le mal est impliqué.
Je tenterai ici essentiellement de dire ce qui, de cette horreur entendue là-bas, au Liban, lors de mes rencontres avec d’anciens enfants-soldats, frappe au plus intime, car je ne veux pas en rester au hurlement a-humain, figée dans une paralysie devant l’horreur et sans aucune efficacité ni pour eux, ni pour moi.
À préciser toutefois que mon approche clinique repose spécifiquement sur ces rencontres que j’ai pu avoir avec certains ex-enfants-soldats libanais dix ans après la fin de la guerre. Une lecture psychanalytique de leurs passages à l’acte de terreur montre qu’il s’agit d’une jouissance déshumanisante que la majorité des enfants-soldats ont vécue.
Je reprendrai cette question en évoquant ma rencontre avec un ex-enfant-soldat que j’ai appelé Farid. Sera accentué dans son histoire et ses propos ce qui fait trait commun avec d’autres anciens enfants combattants.
Il faut cependant souligner que l’histoire personnelle de chacun d’entre eux offre une lecture particulière de cette jouissance qui est en rapport avec son expérience subjective.
L’histoire de Farid
Farid est un grand jeune homme très mince, âgé de 35 ans. Il a un visage aux traits réguliers mais crispés et ses gestes sont contenus par une cigarette qui ne s’éteint jamais. Il se dégage de lui l’impression d’un malaise intérieur profond à la fois réprimé et cependant « offert ».
Il raconte son histoire qui recoupe celle de son engagement dans la guerre civile sur un mode haineux, où l’affect fluctue entre rage et culpabilité.
« Occasionnellement », c’est-à-dire quand il a besoin d’argent, Farid est chauffeur de taxi. Célibataire, il vit toujours dans la maison familiale.
Aîné de sept enfants, il ne garde de son enfance que de mauvais souvenirs. Avec son père, il avait une relation de terreur. Celui-ci était sombre, sévère, le frappant pour la moindre faute. Farid n’osait pas le regarder, il pense que son père était un monstre.
« Relation de terreur », « monstruosité », donc. Deux métaphores paternelles assez terrifiantes qui marquent au fer (comme on le verra par la suite) les actes et l’histoire de ce combattant.
À 13 ans, Farid a décidé de ne plus aller à l’école. Il était dans une situation d’échec scolaire difficile à vivre. À 15 ans, il a fait une tentative de suicide. Une question se pose : que s’est-il passé pendant la pré-adolescence et l’adolescence comme changements physiques et psychiques qui l’ont amené à prendre la décision consciente d’attaquer son corps avec l’intention de mourir comme conséquence de cette attaque ?
Entre 14 et 15 ans, Farid a perdu son père. Il a oublié la date. Cette date réveillerait-elle en lui sa rencontre « réelle » avec l’accomplissement de son vœu de meurtre à l’égard de ce père ?
Ainsi, l’adolescence a été marquée par l’échec scolaire, la dépression, la tentative de suicide, la mort du père, mais aussi par la mort tragique du frère cadet.
La rupture : l’événement traumatique
Farid insiste sur l’ancienneté et la permanence d’un malaise qui fait coïncider le trouble qu’il ressent avec le trouble qu’il a ressenti. Il était en train de crier son malaise à travers une enfance malheureuse où déjà « son corps » subissait la fureur et la terreur de l’autre (paternel) au nom de l’Autre (Dieu).
Toutefois, il convient de remarquer que le moment évoqué comme marquant le début de troubles avec son corps, « la rupture », est celui où une bombe a déchiqueté le corps de son frère.
Il dit : « J’ai continué à vivre dans la souffrance jusqu’au moment où une bombe a déchiqueté le corps de mon frère… À cet instant, j’ai senti que je n’avais plus d’âme, je suis devenu un autre… J’avais l’impression que mon âme s’était séparée de mon corps… Je n’avais qu’une idée en tête : me venger. »
Si je m’arrête sur cette énonciation, c’est parce qu’elle constitue, me semble-t-il, la toile de fond de cette haine fratricide à l’égard de l’autre à la fois semblable et étranger, dont la transformation en déchet induit une jouissance déshumanisante à laquelle le sujet s’identifie.
En effet, on peut comprendre cette énonciation littéralement de la manière suivante : « J’ai continué à vivre dans la souffrance jusqu’au moment où mon frère est mort. » Farid ne se rend pas compte de l’ambiguïté de ce qu’il dit, à savoir que l’événement malheureux de la mort de son frère a représenté pour lui une délivrance.
Et, pour satisfaire son désir de vengeance, Farid trouve un cadre idéal, la guerre civile, dans laquelle vont se jouer tous ses conflits.
La haine fratricide à l’égard de l’autre, à la fois semblable et étranger
La vengeance est devenue son seul objectif : elle lui permet à la fois d’assouvir sa haine de l’autre – dont son frère était alors la cible – et de sauvegarder son amour pour le frère mort. Cette dichotomie entre haine et amour, entre âme et corps et entre vie et mort est devenue pour lui une sorte de nouvelle structure déterminant son mode de fonctionnement dans la vie.
De ce fait, la lutte fratricide inconsciente entre ces deux frères (aîné et cadet) rappelle le drame de Caïn et Abel, avec pour différence la réalisation de l’acte de mort. Dans le mythe de Caïn et Abel, le meurtre se produit dans la réalité : Caïn tue son frère Abel 1 (P. Gibert, 1983). Tandis qu’ici, Farid tue fantasmatiquement son frère. La bombe qui déchire le corps de celui-ci vient exaucer un souhait ardent chez lui. Par ailleurs, le dévoilement subit et violent de son fantasme inconscient l’atteint dans son corps même.
Une sorte de dédoublement s’effectue entre les corps de ces deux frères. Son propre corps devient cadavre, comme celui de son frère. Celui-ci est « un double semblable… réel projeté sur une surface extérieure 2 (Ph. Gutton, 1996).
« Mon corps s’est séparé de mon âme », c’est-à-dire qu’il ne sentait plus son corps. Le corps est alors devenu comme mort, déchet comme le corps de l’autre. Cependant, il était là pour le constater.
C’est l’accident, à entendre ici dans le sens qui a prévalu depuis Aristote jusqu’à la fin du XIIème siècle, celui de « hasard malheureux ». « L’accident, tout comme l’événement, c’est ce qui arrive, mais de manière contingente […] La contingence s’oppose à la nécessité qui fait que l’accident est avant tout coïncidence. » 3 (G. Briole et al., 1994) ». C’est l’incalculable : c’est ce qui fait rencontre avec le réel.
Cet événement traumatique qui atteint Farid comporte à la fois une part de réel qui relève de l’accident, l’indicible de la rencontre, et une part de subjectivité par laquelle lui, le sujet, est marqué.
« Je n’avais plus d’âme » est une métonymie qui désigne son être situé entre le corps et l’âme. Il me semble qu’il était là en dehors de la scène, en spectateur de lui-même, regardant ce corps et cette âme – un corps mort et une âme anesthésiée. À partir de cet instant, il est devenu un mort-vivant qui ne cesse de perpétuer sa souffrance.
Mais cette association : « Je suis devenu un autre », montre à la fois sa dépersonnalisation devant la métamorphose qu’il vient de subir et son sentiment d’inquiétante étrangeté devant la naissance d’un autre (de lui…). La suite des événements a montré qu’effectivement un nouvel être, avec une nouvelle identité, un nouveau nom, va se positionner dans ses agirs et ses actes durant toute la période de la guerre civile.
Économiquement parlant, c’est « un modèle […] de réduction des altérités ». Farid « y fait appel afin d’aménager les potentialités trop divergentes qu’il ressent en lui : interrogations… étrangetés et persécutions » 4. Ce jeune homme est resté dans l’indifférenciation, la confusion qui interdit l’individuation. Il n’existe pas. Toutefois, la question litigieuse est celle-ci : pourquoi le dédoublement se déclare-t-il avec le corps déchiqueté du frère cadet ?
Instrumentalisé en machine de mort, ou jouissance et sentiment déshumanisant
La jouissance inconsciente qu’on a pu déduire de la mort de ce frère a déclenché une culpabilité immense. Et cela parce qu’il était confronté à l’horreur de sa jouissance ignorée de lui-même. Ainsi le fantasme dévoilé l’a-t-il mis devant « le vertige de sa nuit intérieure » 5 (R. Gori, 1991).
Par ailleurs, Farid était sidéré, fasciné par une jouissance qui l’envahissait quand il tirait sur les autres, jouissance dont il était à la fois conscient et saisi, particulièrement quand il a été surnommé « père de la terreur » (je reviendrai sur ce point par la suite).
Voyons d’abord d’où émane cette jouissance et quelle est sa source ? Selon la thèse de Freud sur le principe de plaisir, le sujet cherche une autre satisfaction au-delà du plaisir conçu comme apaisement de la tension, une autre satisfaction. C’est cela que Lacan va désigner du terme de jouissance. « Et satisfaire la pulsion, comme l’indique le terme d’au-delà, c’est donc franchir une limite : la barrière du plaisir. » Ce franchissement qui est un débordement « par rapport aux fonctions vitales, au maintien de la vie, implique une mise en jeu de la vie du sujet ». De ce fait, ce franchissement inhérent à la pulsion sera appelé pulsion de mort 6 (D. Sylvestre, 1995).
C’est une jouissance déshumanisante. Une jouissance où le sujet transforme l’autre en déchet auquel il s’identifie. Il rejoint par son acte la part de lui-même qu’il a exclue (« mon corps s’est séparé de mon âme », dit Farid) « et dont paradoxalement il ne peut se séparer 7 (R. Gori, 1993).
Il frappait là où l’avait atteint le corps (de l’autre). C’est, selon R. Gori 8, une aliénation spéculaire. Dans son agir, il cherchait en vain sur les visages de ses victimes la réminiscence d’un affect, « cherchant à fixer […] spéculairement les traces d’une jouissance qui s’envole […] dans la contrainte de répétition » 9 (R. Gori, 1991).
Ce qui s’impose à lui, c’est donc une jouissance interdite, une jouissance du corps hors symbolique, non corrélée à la castration et sur laquelle rien ne peut être dit. D’ailleurs, la jouissance (comme l’expliquent Freud et Lacan) est tout ce qui n’est pas couvert par le langage. Elle ne relève donc pas de l’ordre du symbolique, c’est-à-dire que, comme tout ce qui échappe au symbolique, elle est de l’ordre du réel.
Mais, à côté de cette jouissance, de cette mise en jeu de la vie, coexiste, comme je l’ai mentionné plus haut, une autre jouissance qui est en rapport avec l’utilisation de son arme. D’un côté, « la prise du pouvoir par les armes et la jouissance non barrée par la castration qui s’ensuit » représentent un « enjeu incestueux [qui] engendre une violence sans limites » 10 (A. Houbballah, 1996), particulièrement dans les guerres civiles. D’un autre côté, cette arme « qui relève de l’ordre de la jouissance phallique » 11 est destinée à lancer des rafales et à atteindre le corps de l’autre, le pénétrer, le déchiqueter, le posséder.
Cette jouissance d’être instrumentalisé par les armes en machine de mort a valeur d’une passion narcissique. Ce qui est retiré à l’objet revient dans le moi : de ce fait, il y a une relation de compensation entre investissement d’objet et investissement du moi (auto-érotisme) 12 (S. Freud, 1907). L’équivalence entre l’arme et le membre viril fait de la première un substitut auto-érotique.
La « terreur », une métaphore du Nom-du-Père
En accédant à un grade supérieur dans la milice, Farid fut surnommé « père de la terreur ». Cet enfant-soldat était particulièrement sensible à l’image que lui renvoyaient ses pairs. Mais cet effet miroir le rendait dépendant des catégories de combattants les plus impitoyables dans lesquelles son comportement et les catégorisations de ses chefs l’avaient enfermé. En effet, ceux-ci ont favorisé la formation insufflée par le monstre de cruauté, « son père ».
C’est un signifiant qui lui est attribué et qui l’autorise à toutes sortes de violences. Cette appellation, « père de la terreur », fait de lui une source inépuisable d’initiation à l’horreur. En effet, chaque acte commis consolide sa réputation et anticipe sur ce qu’il est capable de faire. Rien ne l’arrête et aucune instance n’a le pouvoir de le réfréner. Farid a fait de sa violence une base de son identité, un socle qui ne peut être ébranlé sans le mettre en péril. Avec ce surnom, il est devenu le père de son père 13. Autrement dit, il est devenu le père d’une métaphore du nom de son père, c’est-à-dire qu’il a dépassé son père dans la cruauté. Ce trait unaire avec le père l’a placé dans « un rapport intime d’inquiétante étrangeté » 14 (J.-J. Rassial, 1990) qui lui a révélé son erreur.
Par ailleurs, les combattants s’approprient souvent une telle appellation dans un sens dissuasif, indiquant qu’ils s’installent dans la paternité de la violence et demeurent esclaves de cette fonction.
Cette paternité trouve sa justification dans la langue, à partir des lettres qui la constituent : A-B (Père) représente les premières lettres de l’alphabet ; A (aleph) désigne Dieu, et Aleph-Bé désigne le père. La langue est donc structurée dans son essence même à partir du fondement « Dieu-Père », ce qui donne au signifiant une légalité et une légitimité suffisantes à tout passage à l’acte. De ce fait, il ne peut avoir un effet que menaçant lorsqu’il représente le sujet dans la position du père de la chose.
Dans cette métaphore de « père de la terreur », Farid « cherchait en vain les traits et le visage de l’horreur », de la terreur que lui inspirait son père, afin « d’imprimer ce qu’elle échoue à figurer dans le langage » 15 (R. Gori, 1993). Car la terreur paralyse la parole. Elle réalise par l’acte (visuel) ce qui était exclu du psychisme. Faute d’être symbolisés, les événements traumatiques se matérialisent par la compulsion, d’où l’expression de R. Gori, « la terreur appelant la terreur » 16.
Cette formule constitue le prototype même de l’acte qui répète et fait revenir la terreur du père. Ces répétitions obéissent à quelque chose d’autre qui outrepasse le principe de plaisir et que Freud a appelé un « au-delà du principe de plaisir ». Dans ce cas, le champ est ouvert à une jouissance imaginaire sans limite. Le sujet s’installe dans la répétition sans fin puisqu’il échappe à cette instance qu’est la castration symbolique.
À l’extérieur, Farid était dans le rôle de son père face à la fratrie, il terrorisait les autres.
Dans ce contexte, la douleur de l’autre vient à la place de la sienne qui est restée « forclose ». Elle vient suppléer son moi anéanti. En infligeant aux autres sa souffrance physique, qui est restée non symbolisée, il cherche à la voir sur leurs visages. Il devient de ce fait « l’auteur et le produit de son acte » 17.
Cet ex-enfant-soldat est devenu ce qu’il ne voulait pas être, ce qu’il détestait, une copie de l’autre. Il s’efforçait ainsi de n’être que l’autre recommencé.
Enfin, ce que j’ai essayé de souligner me semble essentiel quant à l’impact du traumatisme dans la violence des guerres. Il ne s’agit pas seulement d’une maladie de l’appareil psychique ou du soma, mais d’une souffrance qu’il faut inscrire dans une pandémie de l’humanité, et qui touche environ 300 000 enfants-soldats.
Un exemple saisissant à cet égard est le cri qui traverse toute l’œuvre de Primo Levi : ce ne sont pas seulement le corps et l’âme qui demeurent blessés, c’est aussi « le sentiment d’appartenance à l’espèce humaine ». Ce cri-là a pu être entendu, de façon ambiguë, dans le discours des combattants rencontrés, notamment à travers celui de Farid, qui se sentait « déshumanisé ».
Celui-ci découvre que, dans la guerre, il était à la recherche de quelque chose, et qu’il a abouti par ses actes à ce sentiment de déshumanisation. Il était en train de me demander une confirmation de son appartenance à l’espèce humaine – « Dites-moi que je suis encore un être humain » –, parce qu’il regrette… parce que ce n’est pas ça qu’il voulait, parce qu’il a commis beaucoup de fautes…
La revendication d’appartenance à l’espèce humaine est légitime. Il n’y a pas une idéologie, une religion, une race ou une couleur qui puisse empêcher cette appartenance. Et pourtant, la politique qui consiste à enrôler de force les enfants dans les groupes armés, à les instrumentaliser en machines de guerre, non seulement dénie leur appartenance à l’espèce humaine, mais efface ensuite leur trace de la mémoire humaine.
Le déni et l’effacement ne sont qu’une forme de destruction psychique totale, de meurtre collectif.
Références bibliographiques
Briole G. et al. (1994), L’événement traumatique, Le traumatisme psychique, rencontre et devenir, Paris, Masson, p. 95.
Freud S. (1907), Les explications sexuelles données aux enfants, La vie sexuelle, Paris, puf, 1969, p. 87.
Freud S. (1920), Au-delà du principe de plaisir, Essais de psychanalyse, Paris, Payot, 1981, p. 43-116.
Gibert P. (1983), Mythes et récits de commencements, Bible, Paris, Grasset, p. 120.
Gori R. (1991), Acting-out-de-parole, Cliniques méditerranéennes, 29/30, p. 18-21.
Gori R. (1993), L’horreur en vue, Cliniques méditerranéennes, 29/40, p. 51-55.
Gutton Ph. (1996), La preuve par les autres, Adolescents, Paris, puf, p. 86-87.
Houbballah A. (1996), Le virus de la violence, Paris, Albin Michel, p. 103-130.
Rassial J.-J. (1990), Moments de folie, L’adolescent et le psychanalyste, Paris, Payot, p. 133.
Sylvestre D. (1995), Pulsion de mort et jouissance, La haine, la jouissance et la loi, Paris, Anthropos, p. 237.
Notes
1 P. Gibert, 1983, p. 120.
2 Ph. Gutton, 1996, p. 86-87.
3 G. Briole et al., 1994, p. 95.
4 Op. cit., p. 86.
5 R. Gori, 1991, p. 21.
6 D. Sylvestre, 1995, p. 237.
7 R. Gori, 1993, p. 51.
8 Ibid., p. 50.
9 R. Gori, 1991, p. 18.
10 A. Houbballah, 1996, p. 110.
11 Ibid., p. 124.
12 S. Freud, 1907, p. 87.
13 En Orient, le fils aîné, en général, nomme son fils aîné par le prénom de son père. D’emblée, il est désigné par une nomination qui porte le mot père : abou, et le prénom de son propre père. Par exemple, Abou Ali : abou, père ; Ali étant le prénom de l’aïeul et du fils.
14 J.J. Rassial, 1990.
15 R. Gori, 1993, p. 55.
16 Ibid.
17 Ibid., p. 51.